
« Leurre et malheur du transhumanisme » d’Olivier Rey : la grandeur de l’homme précaire face à la régression technologique

Les éditions Desclée de Brouwer publient le nouvel ouvrage d’Olivier Rey, déjà auteur, notamment, de deux essais parus chez Stock en 2014 et 2016 : Une question de taille et Quand le monde s’est fait nombre.
Olivier Rey est chercheur au CNRS, membre de l’Institut d’histoire et de philosophie des sciences et des techniques ; il enseigne la philosophie à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Son nouveau livre, Leurre et malheur du transhumanisme, a le grand mérite d’expliciter de façon claire et documentée le programme, le discours et, finalement, le mensonge transhumanistes.
Le transhumanisme à l’épreuve de la liberté
Selon lui, ce transhumanisme qui promet un homme augmenté et libéré des contraintes naturelles (nos piètres performances physiques, notre vieillissement, notre mort) conduira en réalité à un homme mutilé et encore plus humilié par les machines qu’il ne l’est aujourd’hui. Un homme qui, ultime régression, deviendra l’esclave d’une nature tyrannique et sans frein, l’esclave d’une légion de pulsions et fantasmes, alors qu’il est de l’essence de toute vie bonne, de tout accomplissement humain et de toute vraie philosophie de chercher à être réellement libre et amoureux de la vérité, et, pour cela, de s’affranchir de toutes les dominations pulsionnelles qui entravent cette quête.
Le transhumanisme est donc un malheur en ce qu’il n’engendre que la passivité de l’esclavage, là où seule la liberté en acte est désirable ; il est un leurre, un double leurre dirions-nous, un leurre pour demain et un leurre dès aujourd’hui : leurre pour demain en ce que, loin de tenir sa promesse d’augmentation, il ravalera l’homme à ce qu’il y a de plus primaire ; mais leurre dès aujourd’hui car son programme et son discours délibérément excessifs, et donc peu crédibles, visent à dissimuler ce qui aujourd’hui a déjà commencé de diminuer l’homme, d’entamer sa vocation relationnelle. Il suffit d’avoir des yeux pour voir cela : c’est l’immixtion des objets connectés dans le sanctuaire conjugal et familial (sur laquelle nous aurions aimé que l’auteur s’arrête), ce sont ces transports en commun remplis d’individus dont les oreilles et les yeux sont en quasi-permanence greffés à des écouteurs et des écrans, ce sont aussi ces quatre mille (pour l’instant) Suédois qui, encouragés notamment par la SNCF locale, ont choisi de se faire implanter, entre le pouce et l’index, une puce utilisant la technologie d’identification par radiofréquence (RFID), puce intégrant les informations contenues dans les cartes de crédit, passeports et autres billets de train – de sorte qu’il suffit désormais, dans le train, de présenter son pouce au contrôleur… Soit, somme toute, un progrès très limité pour qui a encore des yeux pour voir.
Il est probable que seule une prise de conscience, un rappel de la grandeur de notre précarité, soit en mesure de nous faire échapper à ce progrès qui est en réalité une régression car l’amour et l’amitié qui grandissent l’homme n’y ont pas leur place. N’est-ce pas notre précarité, réelle, qui stimule la relation, qui nous pousse à rechercher la rencontre, le secours et l’amitié de l’autre ?
Le projet transhumaniste et son moteur
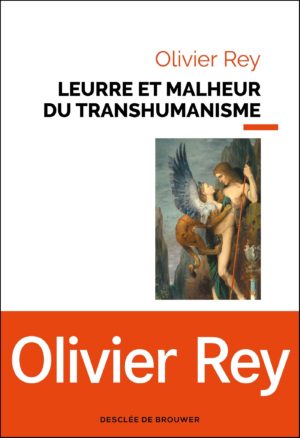 Le transhumanisme – il est essentiel de le définir pour savoir ce vis-à-vis de quoi l’on doit se positionner – vise à transformer non plus seulement le monde mais les humains eux-mêmes, « que ce soit par des interventions sur leur constitution biologique, ou par hybridation avec la machine ». Le renforcement des capacités physiques et cognitives qu’il vise cherche à dépasser les limites que sont les infirmités, les maladies, le vieillissement et la mort ; ce renforcement pourra être d’une telle ampleur que les humains en « bénéficiant » seront, « davantage » que des humains augmentés, « des êtres d’un autre ordre, des posthumains ». C’est pourquoi, selon Olivier Rey, « le trans- de transhumanisme renvoie à la fois au statut de l’humanité comme simple état trans-itoire, à traverser, et à la trans-cendance de nouveaux êtres par rapport à nous-mêmes ».
Le transhumanisme – il est essentiel de le définir pour savoir ce vis-à-vis de quoi l’on doit se positionner – vise à transformer non plus seulement le monde mais les humains eux-mêmes, « que ce soit par des interventions sur leur constitution biologique, ou par hybridation avec la machine ». Le renforcement des capacités physiques et cognitives qu’il vise cherche à dépasser les limites que sont les infirmités, les maladies, le vieillissement et la mort ; ce renforcement pourra être d’une telle ampleur que les humains en « bénéficiant » seront, « davantage » que des humains augmentés, « des êtres d’un autre ordre, des posthumains ». C’est pourquoi, selon Olivier Rey, « le trans- de transhumanisme renvoie à la fois au statut de l’humanité comme simple état trans-itoire, à traverser, et à la trans-cendance de nouveaux êtres par rapport à nous-mêmes ».
Le moteur de ce projet est, selon l’auteur, l’atomisation de la société, sa dispersion en individus, monades impotentes car technologiquement dépassées par leurs outils et par la spécialisation des fonctions, tâches et métiers. Peut-être d’ailleurs Olivier Rey insiste-t-il trop sur ce moteur du manque et de l’impuissance par rapport au « moteur » plus traditionnel, plus inscrit dans la nature humaine, de l’orgueil babélien. Et peut-être en revanche n’insiste-il pas assez sur l’écart croissant, sur ce point, entre pays riches et pays dits « en développement », où c’est davantage la lutte pour la survie que les méfaits du transhumanisme qui est le lot commun.
Mais son constat n’en est pas moins juste : l’individu contemporain des pays riches ne fabrique (presque) plus rien, il consomme, et il est humilié par ses faibles capacités productives en regard des « performances de l’appareil productif général ». Ainsi la puissance des machines actuelles n’est-elle plus « une amplification des capacités humaines, mais leur mortification ». Alors, et l’on entre là dans un cercle vicieux, l’impotent qu’est devenu cet individu s’en remet au « progrès » technologique, attendant un regain de puissance de ce qui lui procurera en réalité un surcroît d’humiliation.
Sophistique et tromperie du discours transhumaniste
De façon particulièrement lumineuse et convaincante, Olivier Rey « déplie » devant nous la sophistique du discours transhumaniste, que l’on retrouve aussi bien, selon lui, dans la promotion du transhumanisme que dans celle des OGM et de la gestation pour autrui (GPA). Cette sophistique se déploie en trois temps. Le premier vise à susciter l’adhésion enthousiaste des populations : sont alors énoncés les « avantages foudroyants » que va procurer le « progrès » scientifique et technologique en cause (vaincre le vieillissement et la mort). Le deuxième temps vise à désamorcer les doutes qui se feraient jour devant cette présentation univoquement flatteuse : on s’applique alors à démontrer la continuité entre ce progrès et l’histoire de l’humanité (les capacités physiques et cognitives de l’homme sont déjà augmentées par le port de chaussures, de lunettes ou de montres !). Le troisième temps, la troisième lame, vise à convaincre les récalcitrants : on avance alors le caractère inéluctable de ce progrès et le risque, pour ceux qui n’en voudraient pas, d’être relégués dans un archaïsme asocial et d’être les grands perdants de la compétition (« il reste trop peu de nature pour que nous puissions y retourner »). On voit que ce discours est, dans ce qu’il promet, trompeur, puisqu’il s’appuie successivement, et même simultanément, sur des arguments contradictoires.
Mais il est aussi trompeur dans ce qu’il cache de la réalité actuelle où, déjà, se déploie le projet transhumaniste : « En poussant à l’extrême la mainmise de la technologie sur l’humain, les perspectives transhumanistes nous font oublier ce qu’il y a de déjà démesuré dans la domination technologique et ses progrès ». La « googlisation et la smartphonisation de l’existence » apparaissent comme « d’innocents gadgets en comparaison de ce qui se prépare ». Bref, le discours au futur vise aussi à faire accepter une réalité présente qui, déjà, déshumanise l’homme en lui faisant préférer le contact d’un écran à la chair d’une autre personne, la greffe d’un écouteur à la voix de son prochain. Cette légitimation du présent vaut aussi pour la GPA qui consiste à faire produire à des corps de femmes des « enfants commandés par d’autres » : en effet, même si celle-ci demeure, pour l’instant, interdite en France, les Français qui y ont recours à l’étranger peuvent obtenir du juge français qu’il lui reconnaisse des effets juridiques en matière de filiation.
L’offre crée le besoin, le moyen devient la fin
Citant Günther Anders, l’auteur relève que l’utilitarisme imprègne l’ensemble de la démarche scientifique contemporaine : la science « ne consiste plus à découvrir l’essence secrète du monde ou des choses, ou encore les lois cachées auxquelles ils obéissent, mais à découvrir le possible usage qu’ils dissimulent ». Au fond, cet utilitarisme est si prégnant, si impérieux, qu’il se moque bien de la question de savoir s’il est utile, c’est-à-dire s’il répond à un besoin. C’est le contraire qui est vrai, et ce pour une raison triviale : « le coût considérable de la “recherche et développement” fait que l’on doit trouver des applications utiles à ce qui est découvert. Dès lors, la solution précède le problème ». Et puisque la « proposition » du progrès scientifique et technologique fait déjà face à un suréquipement de la clientèle solvable, il lui faut désormais prospecter un nouveau marché, celui du corps humain, en proposant l’augmentation de telle ou telle de ses fonctions. Proposition d’autant mieux acceptée que, comme le dit toujours Anders, l’homme contemporain « n’est pas seulement dispersé en une multiplicité d’endroits du monde [comme c’est le cas avec la télévision], mais en une pluralité de fonctions séparées ».
L’offre donc crée et devient le besoin et, concomitamment, le moyen devient la fin. C’est ce que démontre Olivier Rey dans le troisième et dernier chapitre du livre, plus ardu que les deux précédents car axé sur la démonstration épistémologique de l’enracinement du projet transhumaniste dans le dévoiement de la science, particulièrement de la physique moderne. Car initialement consacrée à l’étude du vivant tel qu’il se donne à voir, la physique s’est « mathématisée » pour se consacrer à l’étude de « l’ensemble de ce qui se prête à la mathématisation » et a fait de l’autoconservation de l’être, qui était pour la physique ancienne (celle d’Aristote) un moyen, une fin ; elle a ce faisant supprimé ce qui était une fin pour la physique ancienne. Autrement dit, là où, pour la pensée ancienne et médiévale, « chaque vivant avait un être à accomplir, qui transcendait sa pure et simple existence factuelle » (l’autoconservation n’étant que le moyen d’atteindre cette fin), c’est l’autoconservation qui constitue désormais (au moins depuis Darwin) le but ultime de la vie. Toute préoccupation de ce qu’est une vie bonne disparaît alors nécessairement : Jean-Claude Michéa a bien montré dans ses essais ce que cette disparition devait aussi au triomphe de l’individualisme libéral, notamment dans le dernier d’entre eux, Le Loup dans la bergerie.
Un appauvrissement de la notion d’intelligence humaine
Il faut, pour adhérer au projet transhumaniste, pour être attiré par ses promesses, avoir préalablement réduit et artificialisé l’intelligence humaine afin de la définir comme une simple puissance de calcul, comme un outil destiné à être performant. Terrible appauvrissement qui oublie que l’intelligence réside aussi (et même surtout) dans la faculté de distinguer le bien du mal, le vrai du faux, le beau du laid, qui oublie aussi qu’il y a plus de bonheur et de vérité dans la vie intérieure (le regard porté au fond de notre être) que dans les lunettes de réalité virtuelle.
Cet appauvrissement de la notion d’intelligence humaine ne peut que conduire à l’asservissement de l’homme lui-même, asservissement à la dynamique technologique interne (l’auteur relevant avec justesse qu’il y a dans l’adhésion à cette dynamique « la recherche de la passivité [de sorte que] derrière le désir de maîtrise, se cache un désir de non-maîtrise »), asservissement donc qui conduira lui-même à la domination de certains hommes sur beaucoup d’autres et à la soumission de ces quelques dominants « à ce qui est purement “naturel” en eux, c’est-à-dire à leurs pulsions irrationnelles ». Ainsi, « la conquête de la nature s’avèrera être, au moment de son accomplissement, la victoire de la nature sur l’homme ». On sait que l’angoisse d’un tel destin hante Michel Houellebecq : à la fin de son roman La carte et le territoire, c’est la végétation qui recouvre les anciennes traces de l’activité humaine.
Le courage d’avoir peur
Que faire alors pour éviter ce sombre destin ? Peut-être d’abord retrouver le « courage d’avoir peur » (Olivier Rey reprend ici – volontairement ? – le titre du beau livre du dominicain M.-D. Molinié), parce qu’il y a ici matière à peur, afin ensuite de trouver le courage de surmonter cette peur et d’affronter ce qui la suscite. Peut-être ensuite se libérer de l’individualisme frileux qui ne prête à l’homme que le désir et la volonté de se conserver, pour rejoindre des communautés plus amples (dans leur nombre et leur ambition), présentes mais aussi passées, des communautés qui promeuvent et vivent une autre politique, bien différente des politiques actuelles qui ne visent qu’à légitimer, l’habillant de science et de droit, le fait accompli et, perversion de la démocratie, qu’à faire ce qu’il faut pour remporter les élections à venir. Peut-être enfin dire et redire la communauté de destin qui existe entre l’homme et la nature qui l’entoure, la dignité du premier s’appuyant sur la dignité reconnue à la seconde qui, loin d’être un simple matériau, possède sa consistance et son langage propres. Autant dire aussi que l’on a encore besoin de poètes pour voir et dire cette communauté de destin.
Olivier Rey, Leurre et malheur du transhumanisme, Editions Desclée de Brouwer, 2018, 194 p., 16,90 €


































Le transhumanisme, stade ultime du tout-technologique, pourrait-on dire…
C’est vrai que l’humanité ira probablement jusqu’au bout de sa logique technophile. Mais il ne faut pas oublier que les lois exponentielles du développement humain (c’est pareil pour la démographie) se heurtent à une donnée très simple : la planète Terre est un système fini, et il n’y a pas de croissance infinie dans un système fini. A moins de coloniser toute la galaxie, mais il faudrait encore avoir les moyens de le faire, et il faudrait que cette galaxie soit habitable. Cela n’en prend pas le chemin.
En réalité, je gage que nous nous acheminons vers une régression technologique profonde, qui nous ramènera un – ou plusieurs – siècles en arrière, ce qui, en soi, n’a rien de bien grave. C’est déjà ce que prévoyait la futurologie du philosophe Raymond Ruyer dans « Les cent prochains siècles ». C’est aussi ce que disent les survivalistes.
Peut-on croire un instant à une humanité composée de 20 milliards d’habitants, chacun équipé d’ordinateurs, de portables, de voitures, d’intelligence artificielle, de domotique et autres joyeusetés ? Cette perspective me semble totalement absurde. La technologie régressera en même temps que le technicisme, l’idéologie qui la sous-tend. Et le transhumanisme n’est qu’un élément dans le technicisme. Il disparaîtra comme il est venu. Laissons faire le temps long.
Florian Mazé
Auteur de science-fiction
« 2193 : Le Crépuscule des humanistes »