
“American dirt” de Jeanine Cummins : la rage d’une mère
American dirt de Jeanine Cummins, paru aux éditions Philippe-Rey, nous plonge au cœur de la réalité de la migration au Mexique, de la corruption et de la violence, à travers l’histoire intime de l’amour d’une mère pour son fils. C’est un roman terrifiant et bouleversant écrit à la façon d’un thriller, que l’on ne lâche pas et qui nous donne à réfléchir sur notre humanité.
L’histoire commence à Acapulco, nom aux accents de nuits magiques et de plages paradisiaques, aujourd’hui désertées par les touristes en raison de la forte hausse du taux de criminalité engendrée par la guerre sanguinaire que se livrent les cartels, rivalisant de créativité dans les exactions en une effroyable surenchère. Qu’ils soient riches ou pauvres, les gamins ont tous déjà vu des cadavres dans la rue, signes de la violence ordinaire. Ils connaissent la hiérarchie du danger, savent très bien que certaines familles courent plus de risques que d’autres.
« Parce que les parents qui évitent de parler de la violence en présence des enfants, qui prennent soin de changer de station quand on annonce de nouveaux massacres et de dissimuler leurs pires frayeurs, même ces parents ne peuvent empêcher les enfants de discuter entre eux. Sur les balançoires, sur le terrain de football, dans les toilettes de l’école, les horribles histoires enflent et se répandent. »
Le massacre
Luca sait que ses parents le protègent, font preuve d’un courage sans faille. Il sait aussi qu’il existe des « croque-mitaines modernes ». Luca a huit ans quand sa vie sort de ses rails. C’est un samedi d’avril, la famille est réunie pour fêter la « quinceañera » – le quinzième anniversaire – de sa cousine Yénifer. Il est aux toilettes quand une balle vient se ficher dans le mur près de lui, quand sa mère Lydia le précipite dans un recoin de la douche, le protégeant de son corps et lui intimant le silence. Il ne sait combien d’heures passent avant de remarquer le silence de fin du monde, avant de reprendre conscience dans une autre dimension. Il ne verra pas le massacre, ne pourra qu’imaginer – et c’est peut-être pire – les seize corps sans vie dans la cour de son abuela, sa famille. Lydia appelle la police en dépit du fait de savoir que celle-ci n’est pas là pour aider.
« Le taux d’affaires criminelles non résolues au Mexique dépasse les quatre-vingt-dix pour cent. L’existence d’une ‘‘policia’’ en tenue constitue un contrepoids illusoire à l’impunité réelle du cartel. »
Lydia n’ignore pas que beaucoup de policiers sont à la solde des narcotrafiquants « pour un traitement trois fois plus élevé que celui qu’ils reçoivent du gouvernement. En fait, l’un d’eux a déjà envoyé un texto au ‘‘jefe’’ signalant que Lydia et Luca ont survécu. Les autres ne font rien, parce que c’est justement pour ça que le cartel les paie, pour augmenter le nombre d’uniformes et donner l’apparence d’un gouvernement actif. » Elle comprend vite qu’elle ne peut faire confiance à personne et qu’il lui faut fuir, trouver l’énergie de sauver ce qui peut l’être, son fils et elle-même ; elle laisse le chagrin pour plus tard. Elle doit fuir Javier Crespo Fuentes, l’homme à la tête du puissant et sanguinaire cartel « Los Jardineros », l’homme duquel son mari Sabastián, journaliste d’investigation, a fait le portrait dans la presse, cet homme qui était son ami.
Javier
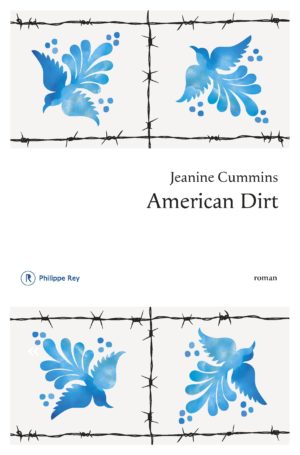 Lydia rencontre Javier dans la librairie qu’elle tient tant bien que vaille face au manque à gagner dû à l’assèchement de l’afflux de touristes, payant les « mordidas » exigées par le cartel. Elle est émue par l’homme qui emporte deux de ses livres préférés, c’est si rare. Il semble séduit et revient parler littérature, musique, poésie.
Lydia rencontre Javier dans la librairie qu’elle tient tant bien que vaille face au manque à gagner dû à l’assèchement de l’afflux de touristes, payant les « mordidas » exigées par le cartel. Elle est émue par l’homme qui emporte deux de ses livres préférés, c’est si rare. Il semble séduit et revient parler littérature, musique, poésie.
Leur amitié se développe avec une rapidité et une intensité surprenantes, une intimité jamais connue en dehors de sa famille. Ils deviennent confidents. Javier lui parle de sa femme, « la reina de mi corazón » (« la reine de mon cœur »), de sa jeune maîtresse, « la reina de mis pantalones » (« la reine de mon pantalon »), et lui avoue qu’elle-même est « la reina de mi alma » (« la reine de mon âme »). Lorsqu’il lui déclare que s’il l’avait rencontrée dans une autre vie, il lui aurait demandé de l’épouser, elle devine qu’elle aurait pu dire oui à cet homme intelligent, chaleureux, dont elle a vu la vulnérabilité, et qui lui parle de sa fille unique Marta avec des étoiles dans les yeux.
Arrive le moment où elle lit l’article de Sebastián, portrait de La Lechuza (La Chouette), baron de la drogue à la tête des Jardineros, qui aurait pu être un entrepreneur à succès au lieu d’être « un affreux boucher qui se prenait pour un gentleman », « un bandit qui s’imaginait poète ». Sebastián est un idéaliste aux yeux de qui une presse libre constitue la dernière ligne de défense. Lydia lui assure – ce dont elle s’en voudra – que Javier appréciera son article somme toute flatteur, un article qui l’a glacée d’effroi et fait s’évanouir l’affection qu’elle avait pour Javier. Une semaine après la parution, survient le drame qui a fracassé sa vie et l’a précipitée sur les routes.
La fuite
Lydia sait comment faire, elle a retiré ses économies de la banque et s’est débarrassée de son téléphone. Peu à peu, parce que la peur semble avoir des pouvoirs magiques, le brouillard des émotions laisse apparaître un plan : elle va suivre la route des migrants, s’éloigner de Javier qui lui a écrit « ta souffrance sera brève ». Chaque kilomètre, chaque minute augmentent les chances de survie.
« Lydia comprend brutalement qu’il ne s’agit pas le moins du monde d’un déguisement. Avec leurs sacs à dos bourrés : ils sont bel et bien des migrants. Et ce simple constat, plus que les nouvelles réalités pénibles de son quotidien, lui coupe le souffle. Toute sa vie elle a plaint ces pauvres gens. Elle a donné de l’argent. Elle s’est interrogée, avec cette sorte de fascination de l’élite douillettement installée, sur l’extrême dureté de leur vie qui les obligeait à considérer, d’où qu’ils viennent, qu’ils n’avaient pas de meilleure solution. Comment ils en arrivaient à quitter leurs maisons, leur culture, leurs familles, leur langue même, et à risquer les pires dangers, leur existence, pour éventuellement réaliser leur rêve de pays lointains qui ne veulent même pas d’eux. »
Elle a abandonné la voiture familiale facilement repérable, il lui est impossible de prendre l’avion ; alors, pour éviter les barrages routiers omniprésents des Jardineros, lui reste la solution de la « Bestia », un train de marchandises sous la coupe de la mère des cartels, une organisation cauchemardesque, dans lequel il faut monter quand il roule. Une idée folle, pourtant il n’y en a pas de meilleure.
Si Lydia reste méfiante, elle rencontre chaleur et solidarité, notamment avec Rebecca et Soledad, deux adolescentes qui fuient le Honduras et la violence d’une petite frappe – « leur gentillesse, leur humanité, bref, leur existence a nourri cette part primordiale d’elle-même qui s’était desséchée. » Unies par l’expérience du traumatisme, elles décident de voyager ensemble. La peur qui dévore, les épreuves traversées, le chagrin et l’épuisement soudent les migrants. Lydia se découvre capable de faire des choses insensées et s’interdit de s’adapter à cette situation inédite parce qu’elle juge vital de rester sur ses gardes. Elle apprend que beaucoup de femmes doivent accepter d’être cuerpomático, leur corps vu comme un distributeur automatique, prix du passage ; que la migra qui procède aux rafles ne renvoie pas toujours les migrants, profitant de l’occasion pour pratiquer du chantage aux familles. Elle s’interroge : « Est-ce que ces hommes font la navette pour aller travailler ? Si c’est comme ça que ça s’appelle ? Est-ce qu’ils embrassent leurs femmes et leurs enfants le matin, grimpent dans la berline familiale et partent pour une journée de viols et de chantages, puis reviennent le soir, épuisés et affamés, manger leur rôti de bœuf ? » Et quand l’on rencontre la bonté, celle à laquelle l’on a encore envie de croire, fatalement on s’en méfie.
« Luca a du mal à accepter l’authentique bonté de tous ces inconnus. Il semble impossible que des gens bons – tant de gens bons – existent dans le même monde que les hommes qui tuent des familles entières durant des fêtes d’anniversaire, puis mangent leur poulet auprès des cadavres. Le cerveau de Luca est envahi d’un rugissement épuisant de confusion lorsqu’il tente de mettre ces faits sur le même plan. »
La polémique
American dirt a suscité, dès sa parution aux États-Unis, une polémique, une levée de boucliers de la part de quelques Sud-Américains qui ont accusé l’auteure d’appropriation culturelle, pointé les erreurs et les stéréotypes. Comment une Américaine qui a passé son enfance dans le Maryland et qui habite à New-York peut-elle être légitime en parlant des migrants ? Parce qu’elle est écrivaine et que la fiction permet de relayer la réflexion, parce que le roman est un lieu de liberté d’expression, une zone de non-droit, parce que la littérature est habitée par le souci de l’humain, parce qu’elle est là pour bousculer et interpeller le lecteur, parce qu’écrire c’est choisir de voir – voir la beauté, la justice, la dignité, etc. –, ne pas détourner le regard. Dans L’art du roman, Milan Kundera écrit que les personnages sont des « ego expérimentaux ». La fiction n’a-t-elle pas permis, entre autres, à Flaubert de se glisser dans la peau d’une femme dans Madame Bovary, à Jonathan Littell dans celle d’un ancien SS dans Les Bienveillantes ?
Oubliez cette polémique ! Après tout, l’empathie n’est pas condamnable et comme l’écrivait Steinbeck à propos de son roman Les raisins de la colère : « De bout en bout, je me suis efforcé de faire participer le lecteur à une actualité. Ce qu’il en retire dépend de son degré de profondeur ou de superficialité. Il s’agit de se mesurer à soi-même. »
Oubliez et lisez ce roman terrifiant et bouleversant écrit à la façon d’un thriller, qui fait battre le cœur plus vite d’émotions fortes, primitives. Lisez ce roman où la tension ne se relâche pas, qui nous plonge dans la crasse et la corruption, au plus profond des noirceurs de l’âme et qui nous montre aussi la force des rêves, de la volonté de survivre, de la solidarité. Lisez ce roman qui est, avant tout, l’histoire du combat d’une mère pour son fils et de son lumineux amour.
.
Jeanine Cummins, American dirt, traduit de l’anglais (États-Unis) par Françoise Adelstain et Christine Auché, Éditions Philippe-Rey, 2020, 544 p., 23 €
Découvrir toutes nos critiques de livres

































