
La mort et ses héritages : Joyce Carol Oates à son sommet
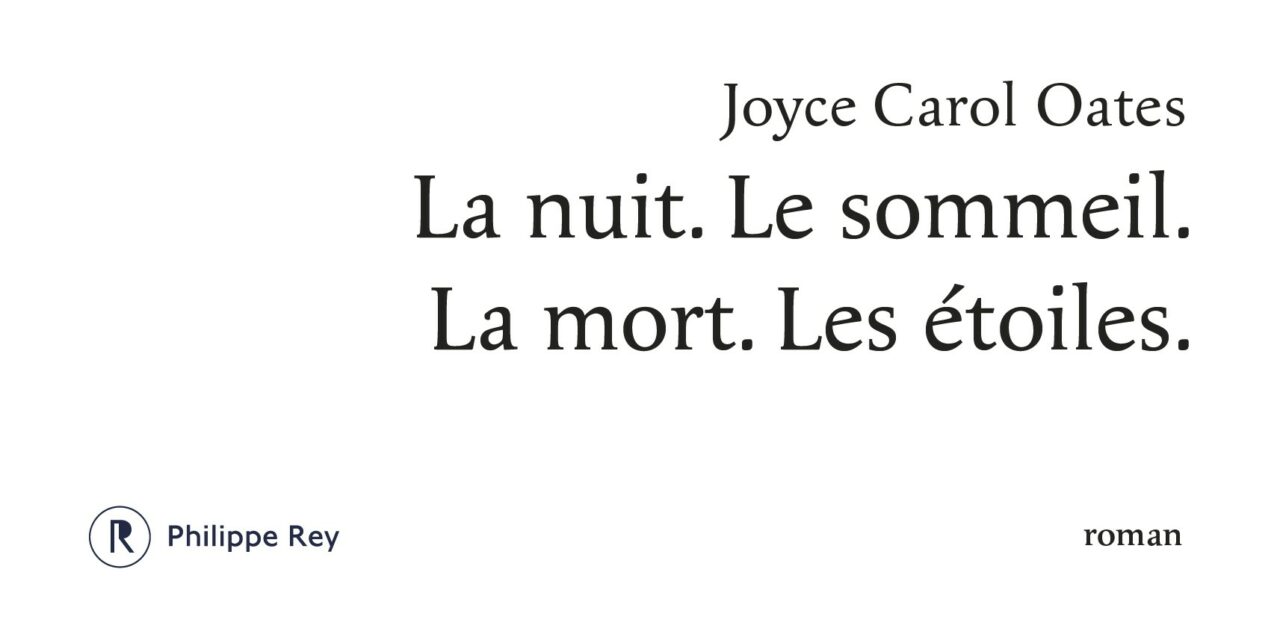
La nuit. Le sommeil. La mort. Les étoiles., le dernier roman de Joyce Carol Oates, paru aux éditions Philippe Rey, est une ample fresque familiale qui nous plonge au cœur du drame de la mort d’un père et de toutes les questions qui s’ensuivent. À travers l’intime, l’auteure dresse aussi le portrait de son pays où le racisme est ordinaire, la violence endémique et les clivages sociaux prégnants. Joyce Carol Oates à son sommet !
John Earle McClaren, surnommé Whitey en raison de cheveux précocement blanchis, ancien maire de Hammond, homme d’affaires reconnu, rentre d’un conseil d’administration des bibliothèques lorsqu’il voit, sur le bas-côté de la Hennicott Expressway, des policiers malmener un homme à la peau brune. « Parce qu’il avait vu quelque chose qui lui paraissait anormal et qu’il était en son pouvoir ou en tout cas de son devoir moral de redresser la situation, ou de s’y efforcer », il intervient. Nous sommes le 18 octobre 2010, en pleine après-midi, son geste humain et courageux est le battement d’ailes du papillon à l’origine des profonds changements que vont vivre les membres de sa famille.
La strate sociale
L’inspiration de Joyce Carol Oates lui vient de l’observation de l’air du temps, qu’elle radiographie avec un regard acéré, en évitant tout jugement moral. Elle s’empare de l’actualité encore brûlante et nous offre de la considérer sous des angles divers ; il s’agit, dans ce roman, de l’affaire George Floyd, mais c’est un Blanc qui est terrassé. Whitey, venu au secours du docteur indien Azim Murthy dont la seule faute est de n’avoir pas la couleur de peau réglementaire, se fait mettre à terre par des policiers fous de rage et, son cœur souffrant ne supportant pas les décharges de Taser, un AVC le plonge dans le coma. Au-delà du racisme endémique à la société américaine, l’auteure pointe du doigt les multiples violences policières et l’impunité honteuse qui les couvre – des plaintes et des rapports disparaissent comme par magie, certains policiers n’hésitent pas à menacer, à harceler, forts de la peur qu’ils inspirent.
Le racisme sociétal a semé des graines au sein de la classe aisée dont la famille McClaren incarne l’arrogance, les préjugés y sont préceptes de vie. La mort de Whitey, le 29 octobre, à la suite d’une infection aux streptocoques, vient dynamiter l’image d’Épinal d’une famille déjà fragilisée par de souterraines fissures.
« Sans Whitey, quelque chose avait sauté. Une cheville. Les choses dérapaient. »
La strate familiale
Whitey et Jessalyn ont eu cinq enfants aux yeux desquels ils forment le couple idéal ; tous ont été jaloux du lien très fort qui les unit, tous ont une vie où se devine la patte du père. La mort de ce dernier les laisse désemparés, la violence du choc leur fait remettre en question des choix qu’ils réalisent n’être pas entièrement les leurs.
Thom, l’aîné, était le bras droit de son père, « à près de quarante ans, il était toujours le jeune garçon compétitif et agressif, le plus intelligent des enfants, ou en tout cas le plus charismatique, séduisant, robustement viril, le sourire cruel et incisif ». Quand il découvre la cause réelle de la mort de son père, il n’a de cesse que de réclamer justice, flirtant dangereusement avec une envie de vengeance. Sa croisade influe irrémédiablement sur le cours de sa vie.
Beverly a trente-six ans, dont dix-sept ans de vie commune avec Steve. Elle s’est donné pour mission de fonder la famille idéale et, en vertu de cela, bonne pâte, elle a beaucoup supporté. À présent, la colère l’envahit envers ses enfants condescendants qui moquent son anxiété et son poids, envers son mari, sarcastique, qui lorgne – et pas que – les filles plus jeunes. Trop longtemps soumise, la mort de son père lui dessille les yeux.
Lorene est proviseure au lycée de North Hammond où elle s’est vu affubler du surnom de « Mme Gestapo » par ses élèves. Elle est sûre d’elle, autoritaire et suffisante, méprisant plutôt les femmes, encline à s’identifier aux hommes. Son credo est « ne jamais oublier et ne jamais pardonner ». Elle travaille d’arrache-pied, galvanisée par une unique obsession : obtenir un classement plus élevé à son lycée dans le top des établissements scolaires. La mort de Whitey fêle la surface de roc d’une jeune femme qui, au final, est restée la petite fille de son père.
Sophia, la benjamine, a vingt-huit ans ; elle travaille dans un laboratoire de biologie qui planche sur un traitement anti-cancer. Recherchant l’admiration et l’amour inconditionnel de ses parents, elle ne s’est jamais autorisé l’intimité durable avec qui que ce soit. Alors, que faire de ses sentiments pour Alistair Means, son patron, un homme plus âgé dont l’intelligence l’éblouit ? Le bouleversement conséquent à la mort de son père la pousse hors de ses retranchements, la fait grandir.
Enfin, il y a Virgil, le vilain petit canard de la famille, le doux rebelle, le hippie vegan, l’artiste trop original qui, après avoir abandonné ses études et voyagé quelques temps, est revenu s’installer à North Hammond où il vit dans une ferme collective.
« Se penser ‘‘Virgil McClaren’’ lui donnait l’impression d’être pris au piège, d’étouffer. Le sens de la vie n’était pas une identité personnelle étriquée, mais un moi impersonnel plus élevé. Le grand objectif de sa vie était de nettoyer son âme. »
Il sera « Virgil », un homme de trente-et-un ans que ses frère et sœurs jugent infantile, à l’exception de Sophia. Il porte constamment avec lui la mort de son père mais est celui dont la vie est la moins affectée.
Si « une famille est un champ de bataille où alliés et ennemis changent sans cesse de camp », la lecture du testament allume la mèche de nombreuses déflagrations.
« La lecture d’un testament est une zone de turbulences : après qu’il a été lu, secousses et ondes continuent comme après toute agitation de l’air, de l’eau ou de la terre. »
Leur mère, Jessalyn, les réconforte plus qu’elle ne s’autorise elle-même à pleurer. Elle est désormais une veuve, c’est son essence.
La strate intime
Que devient l’existence privée de la personne avec laquelle on a vécu près de quarante ans ? Comment faire sans cette présence fidèle, réconfortante, fondatrice, volée inopinément, bien vilaine surprise ? Jessalyn ne sait que faire de la tristesse et de la pudeur des autres – « Les mots font défaut, aussi insubstanciels, aussi idiots que des bulles de savon » –, elle ne sait même plus comment faire pour rester debout, parce que « la mort transforme le connu en inconnu ». Longtemps, elle a été l’épouse et la mère parfaites ; aujourd’hui elle n’est plus que la veuve, une vie absurde comme « un ruban de Möbius sans fin », assiégée par la culpabilité d’être encore là et par un chagrin qui l’assaille de toutes parts. Elle n’est plus qu’une femme désincarnée que tous traitent comme une convalescente, que ses enfants infantilisent.
« Elle redoute leur pitié. Plus encore, leur compassion bien intentionnée, comme une pâte collante sous les ongles. Elle ne souhaite qu’une chose : fuir. »
Elle tient bon, accueille « un matou à l’œil louche. Un vétéran aux oreilles balafrées […] massif, lourd, près de dix kilos, de la taille d’un porcelet », Mack le Surineur, comme elle le nomme, sera sa bouée de sauvetage. Peu à peu, elle redevient elle-même, un horizon est à nouveau là, personnifié par Hugo Martinez… au grand dam de ses aînés : comment ! Un artiste ? Hispanique qui plus est ? De quoi vont-ils avoir l’air ? Et puis, comment imaginer une vie sexuelle à leur mère ?
Jessalyn est déterminée à garder son bonheur tout neuf, parce qu’être mère n’est qu’une partie de son être, elle est également et avant tout une femme – « la veuve veut vivre, être en deuil ne suffit pas. »
La strate de l’écriture
Joyce Carol Oates est une auteure prolifique – un roman et un recueil de nouvelles par an – dont la plume vieillit de la même façon que les meilleurs vins. La nuit. Le sommeil. La mort. Les étoiles. est un roman que l’on ne peut lâcher, où elle fait l’autopsie de son pays au prisme de l’histoire d’une famille touchée par le malheur. De l’intime au public, avec une haute maîtrise et un regard fin, elle brasse de multiples sujets : le racisme ordinaire, les clivages sociaux, la justice, le deuil, la famille, l’identité, encore ce qu’est être une femme et une veuve.
Elle sonde ses propres émotions pour en extraire ce qu’il peut y avoir d’universel – elle se retrouve beaucoup dans Jessalyn, l’écrivaine étant veuve de son premier mari, Raymond Smith, foudroyé en 2008 par une maladie nosocomiale après quarante-sept ans de mariage. Elle aime les personnages qui perdent pied sans pour autant s’effondrer ; il arrive un moment où l’on cesse de pleurer. Elle parle avec talent de tout ce qui peut nous entraver ou nous libérer, des paradoxes auxquels nos choix nous confrontent : partir ou rester, être mère ou pas, changer de voie ou pas…
Le style de Joyce Carol Oates est vivant, corrosif, nourri de phrases déliées où trouvent leur place italiques et incises, autant de dialogues intérieurs qui reflètent la complexité de l’existence et les nombreuses questions qu’elle génère.
Je relaie ici les mots si justes de S. K. Oberbeck dans le Washington Post Book World du 17 septembre 1971 : « Lire Oates, c’est comme traverser un champ de mines émotionnel, être secoué au plus profond de son âme par de multiples explosions. » Lire Joyce Carol Oates, c’est trouver un écho de soi, de nos certitudes et de nos doutes, de nos joies et de nos tristesses, de nos renoncements et de nos colères, c’est ne jamais oublier qu’il y a une lumière dans les ténèbres, des étoiles dans la nuit.
.
Joyce Carol Oates, La nuit. Le sommeil. La mort. Les étoiles., traduit de l’anglais (États-Unis) par Claude Seban, Ed. Philippe Rey, 2021, 928 pp., 25 €
.
DÉCOUVRIR TOUTES NOS CRITIQUES DE LIVRES

































