
La musique contre la barbarie
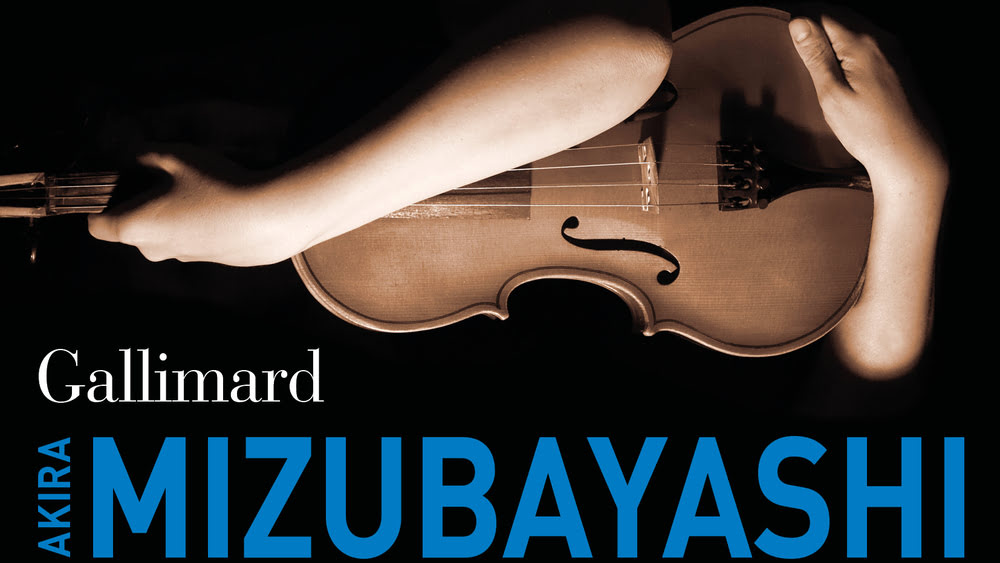
Akira Mizubayashi signe, aux éditions Gallimard, Reine de cœur, un troisième roman choral et mélodieux, au rythme calqué sur celui d’une symphonie en cinq mouvements qui disent les atrocités de la guerre, la folie des hommes, l’agissante transmission et les remparts consolateurs que sont l’amour et la musique.
Reine de cœur est un roman polyphonique qui, comme le superbe précédent roman de l’auteur, Âme brisée, est construit à la manière d’un puzzle : plusieurs voix se font écho, s’entrelaçant par-delà les ans.
Les hommes
L’histoire commence en 1937, lorsque Jun Mizukami débarque de son Japon natal à Paris pour étudier l’alto sous la direction du célèbre professeur Maurice Vieux. Il a vingt-trois ans, ne maîtrise pas bien la langue française mais il est passionné de musique, langage universel, et ne se sépare jamais de son instrument. Il prend ses habitudes au bistrot « Chez Fernand » où il arrive invariablement à 13h10, s’installe à une table du fond et commande invariablement le plat du jour. Il y rencontre Anna, venue seconder son oncle pour le coup de feu de midi. La jeune femme éprouve vite de l’intérêt pour l’homme aux habitudes très régulières, le musicien-philosophe discret et attentionné. Deux ans plus tard, à Marseille, au bien nommé « L’hôtel de l’Espérance », le couple se sépare. Jun retourne à Yokohama où il va intégrer l’armée. Il promet à Anna de revenir dès que cessera la folie des hommes. Qu’adviendra-t-il de l’amour de ces jeunes gens qui appartiennent à des camps opposés, la France et le Japon, « un pays en proie à la folie belliciste, au désir d’expansion coloniale, à la politique fanatique d’un État militarisé obligeant tout un chacun à suivre corps et âme la “voie des sujets” désignée par l’empereur, forçant ainsi toute raison et tout esprit critique à s’effacer, à se taire complètement et durablement. »
Ayako est infirmière à l’hôpital militaire de Tokyo. En 1945, la guerre épuise et s’épuise. Ayako, en dépit des horreurs qu’elle a vues, continue à faire preuve de bienveillance envers les soldats qui reviennent hagards, comme fous, des combats, tout en prenant soin de sa mère atteinte de fièvre typhoïde. Elle meurt à soixante-quatorze ans, léguant à son petit-fils Otohiko un journal intime où elle raconte sa rencontre avec l’homme qu’elle a épousé, deux cœurs blessés et tourmentés unis par la douleur. Accompagnant ce précieux document, Otohiko trouve le Journal intime de ma vie de soldat, un témoignage cru et bouleversant de la condition d’un soldat de l’armée de terre impériale, engagé dans une guerre sacrée selon Sa Majesté impériale, en vérité une guerre féroce aux actes de barbarie infondés et innommables.
« Personne ne peut lutter contre l’État militaire et son armée fanatisée. Cette guerre d’agression coloniale est comme un train conduit par un cinglé, personne ne peut l’arrêter… »
En 2007, Marie-Mizuné Clément est premier alto solo dans l’Orchestre philarmonique de Paris. À la sortie d’un concert, dans le bus qui la ramène chez elle, un sexagénaire aux cheveux argentés, qui a assisté au concert et l’a reconnue, entame la conversation et lui conseille le livre L’oreille voit, l’œil écoute, écrit par Oto Takosch, « le portrait poignant d’un homme épris de liberté, d’art et d’amour ». Le livre, lu l’espace d’une nuit, la laisse horrifiée et fascinée. Aiguillée par la curiosité, elle entame des recherches qui donneront à sa vie un tour inattendu.
La musique contre la barbarie
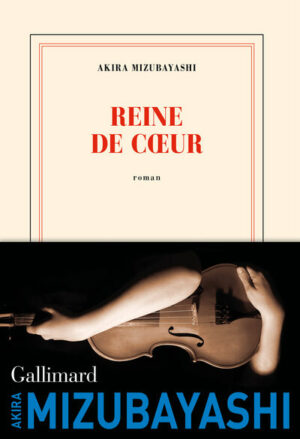 Le roman parle de musique, notamment de la Huitième Symphonie de Dmitri Chostakovitch dont il reproduit le rythme dans sa construction, suivant les mouvements, subtile mise en abyme qui dénonce l’absurdité de la guerre.
Le roman parle de musique, notamment de la Huitième Symphonie de Dmitri Chostakovitch dont il reproduit le rythme dans sa construction, suivant les mouvements, subtile mise en abyme qui dénonce l’absurdité de la guerre.
L’adagio, le premier mouvement de la symphonie, se joue fortissimo et est très sombre. Le roman s’ouvre sur une scène intenable, proprement inhumaine. Nous sommes en février 1945, Jun Mizukami, jeune soldat de troisième classe, se voit intimer l’ordre par le sergent-major Ashibé de décapiter un prisonnier chinois. « Broyé sous le poids d’une hiérarchie militaire au sommet de laquelle est assis un prince divinisé », le vaillant soldat se refuse pourtant à commettre l’acte. Sa voix intérieure se montre plus tonitruante que sa terreur.
« Non, tu ne peux pas faire ça, tu ne DOIS PAS… tu es un HOMME avant d’être un Japonais… Tu es nécessairement un homme, et ce n’est que par hasard que tu es japonais… Ta naissance est un pur hasard. Il n’y a pas de quoi être fier… Par contre, sois fier d’être un homme, un HOMME… »
Le deuxième mouvement, l’allegretto, se joue sur un tempo rapide, a un caractère endiablé dû aux gammes vertigineuses et aux accords dissonants, illustrés dans le roman par les vertiges de l’amour et par les dissonances du destin qui provoquent la séparation des amants.
Le troisième mouvement, en musique comme dans le roman, est court. L’allegro non troppo de la symphonie se pare des notes hurlantes des bois et d’une tonalité aux accents burlesques, un écho au coup de tonnerre dans la vie de Marie-Mizuné.
Le largo, quatrième mouvement au tempo lent tout en tension, est telle une marche funèbre. Nous revenons, dans le roman, au journal de guerre du jeune soldat qui a tout fait pour ne pas perdre son âme, au risque de devenir fou. Oto Takosch en a tiré un livre intitulé L’oreille voit, l’œil écoute, titre parfait pour définir le ressenti du soldat parce que, quand il « entend de la musique, il voit des choses ; et inversement, il entend de la musique quand il est en présence de certaines scènes », parce que « pour lui, la musique devait être apte à rendre compte des horreurs et des folies dont l’humanité était capable sans scrupule », à l’instar de la musique de Chostakovitch dont le compositeur polonais Krysztof Meyer dit : « Cette musique nous livre l’une des confessions les plus intimes de l’artiste, une preuve bouleversante de son engagement évident face aux événements de la guerre, un cri de protestation contre le mal, la violence et la volonté de suprématie. »
La musique se fait commentaire du poids du monde et de son oubli dans les étreintes, de la guerre qui déshumanise. La symphonie est une épopée de la souffrance qui fait passer un message de compassion et de tristesse.
« Si le premier thème joué fortissimo par les instruments à cordes les plus graves était comme la métaphore de la menace de mort engendrée par les destructions massives, le deuxième introduit pianissimo par les premiers violons sonnait comme l’expression rentrée d’une lamentation déchirante […]
Les oreilles d’Oto furent frappées par l’entrée glissante du cor anglais dont la sonorité aussi noble que fragile semblait souligner la solitude d’un soldat écrasé par l’attente torturante d’un combat sans merci. Mais la voix du soldat s’éclipsa sans tarder, engloutie dans les cris de douleur poussés à l’envi par tous les violons jouant fortissimo. À partir de là, la musique s’intensifia, s’amplifia, s’embrasa même avec la participation de plus en plus nombreuse d’instruments y compris les percussions – les timbales, la caisse claire, la grosse caisse, le xylophone -, comme si tout l’orchestre explosait, comme si la musique était devenue un gigantesque champ de bataille avec toutes sortes de bruits réels et imaginaires : bruits d’armes à feu, bruits d’artillerie, bruits d’avions de combat, bruits de soldats qui vont de l’avant et s’entretuent et, enfin et surtout, bruits assourdissants provenant des cauchemars de tous les combattants survivants […] On remarquait, au seuil du troisième mouvement, qu’une extrême tension habitait le corps d’Andris Lensons (le chef d’orchestre, NDLR) […]
Bientôt les altos cédèrent leur place aux violons qui, maintenant le principe des notes martelées, subissant régulièrement l’intrusion des violoncelles et des contrebasses comme des coups de poing reçus en plein ventre, suscitaient l’intervention de clarinettes et d’autres instruments à vent émettant, quant à eux, comme des cris stridents proférés par des bouches tordues de douleur. Bref, une fois de plus, les violences de la guerre déferlaient dans la salle implacablement. La musique fonçait à une allure folle ; le martèlement obsessionnel finit par envahir tout l’orchestre et aboutit à un déluge de sons sauvages comme des cris de désespoir émanant d’une gueule ouverte figurée par les cordes, les cuivres et les bois, un déluge sur lequel se découpaient clairement d’innombrables et furieux coups de timbales comme des battements de cœur qui ne cessent de frapper fort et vite jusqu’à la crise cardiaque fatale… L’ensemble sonore, dans son déchaînement général, donnait l’impression d’une danse macabre se déroulant sur un charnier d’innombrables cadavres gisants […]
La transition avec le quatrième mouvement s’opéra sans rupture […] après deux déflagrations orchestrales accompagnées d’étourdissants coups de tam-tam, le thème posé par l’ensemble des cordes, des cuivres et des bois graves allait se transformer en passacaille, c’est-à-dire en une longue série de douze variations qui était, dans une tonalité sombre et recueillie, comme un requiem dédié aux victimes des désastres de la guerre […] Et, à la fin, au moment précis où la musique passait du quatrième au cinquième mouvement […] la tonalité passait, en vertu de quelques notes jouées par trois clarinettes, à l’ut majeur. Comme si, brusquement, une éblouissante flèche de lumière perçait le ciel d’hiver couvert de nuages noirs ou comme si un voyageur égaré dans un désert trouvait providentiellement une oasis verdoyante […]
On sortait enfin d’un tunnel de ténèbres glaciales à n’en plus finir pour s’exposer avec joie à un ensoleillement doux et bienfaisant (…) C’était une longue et bouleversante prière d’une profonde quiétude, une prière universelle sans dieu, sans prophètes, sans religion, sans frontières, prière ardente sans paroles des âmes errantes qui revenaient de loin. »
Ce cinquième mouvement, dans le roman, signe un finale comme une pastorale qui chante l’amour et la re-naissance parce que la vie est toujours en train de se faire.
Akira Mizubayashi est un auteur si raffiné et parle avec une telle grâce de musique que je lui pardonne les quelques mièvreries de style que j’ai rencontrées – par exemple : « son visage s’épanouissait comme une fleur d’hibiscus. » Il possède ce talent de conteur qui tisse des liens entre les personnages de voilements en dévoilements, en autant de pièces de puzzle qui finissent par se fondre les unes dans les autres. Nous retrouvons dans ce nouveau roman les thèmes qui lui sont chers, à savoir le poids des atrocités de la guerre, la transmission familiale, la musique comme vecteur de sens et expression profondément intime des sentiments – langage personnel qui vise à l’universel –, l’amour comme force et ultime rempart.
« J’ai voulu recréer le climat intérieur d’un être humain assourdi par le gigantesque marteau de la guerre. » (Dmitri Chostakovitch)
.
Akira Mizubayashi, Reine de cœur, Gallimard, 2022, 240 p., 19€
.
DÉCOUVRIR TOUTES NOS CRITIQUES DE LIVRES

































