
« La moitié du fourbi » : le cabinet des curiosités de Frédéric Fiolof
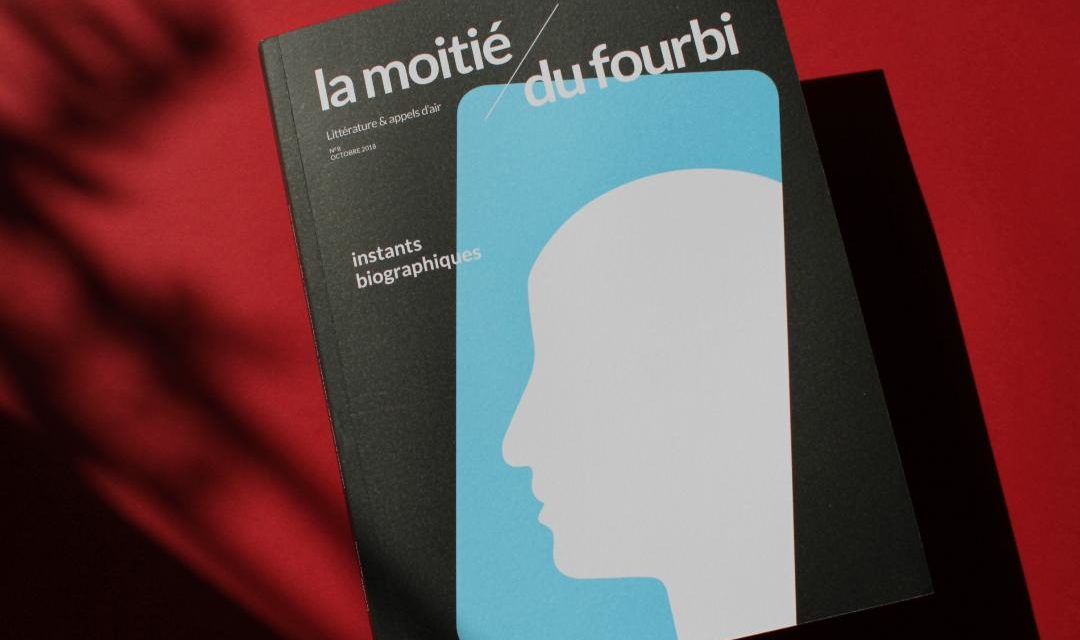
En février 2015 paraissait le premier numéro d’une nouvelle revue au nom quelque peu énigmatique : La moitié du fourbi. Fondée et dirigée par Frédéric Fiolof, cette revue est un monde en soi. Ainsi que l’exprime son directeur, plus de trois ans et huit numéros plus tard : « Je ne conçois pas une revue comme l’application d’un programme mais comme une construction progressive. »
Présentation et entretien.
Une conviction : la revue est un art à part entière.
Un constat : la revue est un art qui ne connaît qu’un faible écho médiatique.
Un engagement : donner à voir, à goûter et à vivre cette magnifique diversité des revues.
Présentation de la chronique des revues
Pourquoi tant de revues littéraires s’interroge-t-on, presque malgré soi, en arpentant les allées du salon annuel de la revue qui se tient à la Halle des Blancs-Manteaux ? Leur profusion, leur dynamisme, leur audace, tiennent, en ces temps de surproduction romanesque, alors que la plupart des yeux se noient dans les écrans, du miracle et de la folie, d’un pari perdu d’avance. C’est que la revue doit avoir quelque chose que la plupart des œuvres littéraires, qui sont des « livres à un coup », n’ont pas.
Et, en effet, la revue propose, donne à voir, à goûter et à vivre ce que la frénésie contemporaine, prise au piège de l’individualisme forcené (l’effroyable solitude des visages penchés sur les écrans, plus effroyable encore d’être inaperçue de ceux qui en sont les inconscientes victimes) et de la tyrannie bicéphale de la performance et de l’immédiateté (le temps dit « réel » qui est la mort de toute durée), s’acharne à détruire : elle propose d’abord une aventure collective, une communauté constituée de celles et ceux qui contribuent à son déploiement, en forment les membres, composent son visage ; elle permet ensuite à cette aventure de s’étendre et s’épanouir dans le temps, de croître et vivre dans la durée.
Une revue donc, c’est une communauté et du temps, c’est un organisme vivant qui se donne la possibilité d’un déploiement progressif, dont l’identité se révèle graduellement au fil des numéros. C’est une voix propre, un timbre et un ton particuliers, qui est déjà elle-même la complexe composition issue de toutes les voix qui s’y expriment.
Il nous semble donc indispensable de donner à la prodigieuse richesse des revues littéraires francophones l’image et l’écho qu’elle mérite. C’est ce à quoi s’attachera notre chronique des revues.
Nous l’inaugurons avec la présentation de la revue La moitié du fourbi, fondée et dirigée par Frédéric Fiolof. Son huitième numéro, intitulé « Instants biographiques », a paru en octobre 2018.
Fidèle à sa volonté de mêler les diverses expressions artistiques, la revue propose, dans ce numéro, des récits autobiographiques (dont l’un sous forme de carnet de voyage, « Fos-New York, CMA-CGM Puget » de Christian Garcin), des récits tout à la fois autobiographiques et bibliographiques (Anne Maurel) ou iconographiques (Hélène Gaudy et les trois photographies de son grand-père), des dessins et bandes dessinées (Perrine Rouillon et Pauline Aubry), des poèmes (Éléonore de Monchy), des biographies d’anonymes (qui ne le sont donc plus : Eloïse Lièvre et son locataire) ou encore des incursions (et excursions) dans des moments et des œuvres d’écrivains qui eux sont célèbres (Nicolas Rozier sur l’écriture par Antonin Artaud de son célèbre Van Gogh, le suicidé de la société ; Zoé Balthus sur le Seppuku de Mishima ; Julia Kerninon sur Jack Kerouac).
Mais, soucieux de donner à la notion de biographie sa dimension la plus universelle et la plus contemporaine, et tout à la fois sa dimension la plus visuelle, ce numéro propose aussi de belles photographies de Magdi Elzain (Aglaé Bory), réfugié soudanais rescapé de la guerre du Darfour.
C’est que la biographie est toujours bibliographie et iconographie (l’on pourrait ajouter : discographie et filmographie), s’écrivant à partir des livres lus, des choses vues, des visages aimés même quittés.
Entretien avec Frédéric Fiolof, directeur de la rédaction de La moitié du fourbi.
.
Pourquoi avez-vous donné ce nom à votre revue ?
Le choix de ce nom est d’abord dû au hasard d’un souvenir, au demeurant assez anecdotique. « La moitié du fourbi » est une formule empruntée au jeu du Loto tel qu’il se pratique dans certains villages du Sud de la France. Le principe de ce jeu (qui connaît des variantes dans d’autres régions de France ainsi qu’au Maghreb et en Italie) est simple : une personne tire des numéros au sort et des participants (réunis dans un café ou une salle municipale) recouvrent à l’aide d’un jeton ou d’un grain de maïs chaque numéro sortant lorsqu’il figure sur leur carton. Le premier participant à avoir rempli la totalité de son carton gagne un lot inoubliable (un jambon, une bouteille de vin…). Comme les numéros vont de 1 à 90, lorsque c’est le 45 qui sort, le « nommeur » fait précéder l’annonce de ce numéro-là d’une tonitruante : « La moitié du fourbi ! ». Allez savoir pourquoi, cette formule m’est revenue lorsque je cherchais un nom pour la revue et j’ai immédiatement su que c’était ça ! Sortie de son contexte, elle avait un air un peu mystérieux qui me plaisait. Et le hasard fait parfois bien les choses : dans « Moitié », il y a peut-être ce double espace (littéraire/non littéraire) qu’essaie d’occuper la revue. « Fourbi » avait quant à lui des résonances sympathiques du côté, entre autres, de Michel Leiris, de Prévert et de ses fatras… Il traduisait aussi l’envie de faire entrer une certaine diversité dans la revue, l’envie de quelque chose d’ouvert.
Quels sont l’esprit (inspiration, raisons de sa création, buts…) et la matière (genre littéraire des publications et des livres critiqués) de votre revue ?
L’envie de vouloir s’inscrire dans un espace qui se joue des frontières entre le champ de l’essai, de l’analyse et celui de la création. La moitié du fourbi est une revue qui relève plutôt de l’univers de la non fiction (pas de nouvelles, de « personnages inventés »), mais s’autorise à peu près tout le reste : récit, témoignage, voyage dans des œuvres, chez des auteurs, mais toujours à partir d’une approche très personnelle (le compte-rendu ou la lecture critique accueille toujours « l’humeur », la référence subjective, le ressenti…). La poésie (qui à nos yeux est fondamentalement non fictionnelle) peut aussi parfois trouver sa place dans nos numéros (Amandine André, Dominique Quelen, Éléonore de Monchy…). Nous ne nous restreignons donc pas à un genre, un courant ou une idéologie mais nous nous efforçons de suivre le fil d’une curiosité toujours réactivée par la « mèche », la porte d’entrée de chacun de nos numéros. Quelque chose entre le « thème » et la « contrainte » et qui nous invite à chaque fois à revisiter le monde en passant par le chas d’une aiguille. Ces mots doivent paraître un peu prétentieux. Disons qu’ils ne sont pas le constat d’un résultat mais traduisent ce qui nous anime… D’ailleurs, je crois (mais c’est un avis très personnel) qu’une revue n’en finit pas de se chercher. Elle suit un chemin, parie sur une intuition et c’est la suite de l’aventure qui doit lui apprendre ce qu’elle est. Je ne conçois pas une revue comme l’application d’un programme mais comme une construction progressive.
Peut-on parler, selon vous, d’un art de la revue ? Quel serait-il ?
La formule est très belle et me semble méritée. Je pense qu’il y a effectivement un art, disons « des arts » de la revue. Et je parle ici plus en tant que lecteur de revues que directeur de publication de l’une d’entre elles. Je vois au moins deux éléments qui militent dans ce sens. La création et l’animation d’une revue appellent d’abord un art de l’engagement. Une revue, par définition, ne prend sens que dans la récurrence. Même si certaines n’ont historiquement pas pu aller au-delà de leur premier numéro, pour « faire revue », il en faut théoriquement au moins deux ! Quelle que soit sa périodicité, la revue s’inscrit dans une temporalité. Un acte de foi doit présider à cette envie de retour, de récurrence. Johan Faerber, avec qui je m’étais entretenu pour Diacritik il y a environ un an, rappelait que Serge Daney, lors de la création de la revue Trafic, affirmait qu’une revue cherche à faire « revenir », à faire « revoir » quelque chose qui sans elle serait resté inaperçu… Peut-être est-ce dans ce pari d’un dévoilement, temporellement inscrit, que se joue « l’art » de la revue. Et j’entends également ce « faire revenir » dans un sens culinaire. Quelque chose doit rissoler avec le temps, prendre goût à feu vif, et à chaque numéro on peut varier les ingrédients.
L’autre caractéristique qui singularise à mon sens les revues, c’est un certain art de l’équilibre interne. Au-delà du principe minimal de la récurrence, tout est possible. Pour ce qui est de sa forme et de son contenu, une revue invente le plus souvent ses propres règles. Elle doit porter en elle-même sa propre justification. De ce point de vue, la notoire fragilité économique des revues est une force : on peut prendre tous les risques, s’affranchir des contraintes de genre, expérimenter, tenter des alliages, des hybridations, ouvrir des espaces de paroles qui trouveraient plus difficilement une place ailleurs, dans les champs souvent plus normés de l’édition… La vertigineuse diversité des revues est là pour en témoigner.
Le dernier numéro de votre revue s’intitule « Instants biographiques » : qu’attendiez-vous des auteurs ? Des fragments d’autobiographie ? La biographie est-elle pour vous un genre littéraire ou (et) le substrat de toute création ?
Au-delà des formes consacrées de la biographie et de l’autobiographie, cette matière que constitue le « vécu » interroge sans cesse la littérature. C’est ce questionnement qui nous intéressait. S’agit-il d’un matériau à dévoyer ? D’une terre vers laquelle on revient sans cesse ? En quels lieux du biographique se croisent, composent ou se télescopent la fiction et le réel ? C’est un peu tout cela que nous souhaitions agiter. Mais à vrai dire, comme à chaque numéro du Fourbi, nous ne pouvions présager de rien. Une fois invité, chaque contributeur ou contributrice est libre de s’approprier la proposition comme bon lui semble (dans le simple respect du cadre, somme toute assez souple, de notre revue). On n’échafaude pas un dispositif, on essaie plutôt de lancer des germes, de convoquer des écritures autour d’un axe relativement élastique, et on laisse ensuite le numéro prendre corps de manière un peu organique. Et il me semble que le résultat kaléidoscopique de ces « Instants biographiques » reflète bien la dimension polymorphe de ce que peut inspirer le (auto)biographique. Des textes parfois très personnels (Hélène Gaudy, Anne Maurel), des coups de scalpel visant à démystifier la spectacularisation des « vies d’écrivains » (Julia Kerninon), le conflit entre la tentation héroïque et l’humilité d’une existence anonyme (Hugues Leroy autour du personnage d’Achille), des exercices d’admiration, des déambulations dans les coulisses de la « biofiction »… et bien d’autres choses encore.
Vous évoquez dans le dernier numéro de votre revue l’histoire tragique, mais féconde, de l’écrivain juif Raymond Federman, que sa mère cacha précipitamment dans un débarras un matin de juillet 1942 afin de le faire échapper à une rafle de la Gestapo, lui disant ce dernier mot en guise d’adieu : « Chut ! » Diriez-vous que le silence est le début, la source de toute parole, qu’il est la terre nécessaire à la croissance de toute œuvre ?
Je ne sais pas. En effet, toute parole porte sans doute en elle la part de silence qui la rend à la fois possible et vaine. Mais chez certains auteurs, cette tension est plus prégnante, plus déterminante que chez d’autres. Toute l’œuvre de Federman gravite autour de cet instant impensable, de ce geste maternel qui l’a condamné au silence pour lui permettre de survivre et donc, paradoxalement, de renaître à la parole. Il y aussi Perec, bien sûr, qui dans W ou le souvenir d’enfance entrecroise les bribes mémorielles d’une enfance volée à une étrange histoire qui se déplie comme la fleur noire d’une allégorie concentrationnaire. On pourrait aussi évoquer les circonvolutions de La Disparition ou l’impossible puzzle de La vie mode d’emploi. Quelque chose se dit, qui ne veut pas, ne peut pas se dire. Dans un autre registre, je pense aussi à l’écrivain uruguayen Carlos Liscano, qui s’est inventé écrivain dans les geôles de la dictature de son pays pour survivre à l’ennui et à la torture (son lot quotidien de 1973 à 1985), bien avant d’avoir écrit une seule ligne. Une vocation qu’il finira par incarner à travers une œuvre mélancolique, nocturne, qui mesurera avant tout à quel point écrire, c’est écrire autour du silence… Il raconte tout cela dans un livre admirable, L’écrivain et l’autre. Un livre qui aurait lui aussi pu trouver sa place dans une réflexion sur les « instants biographiques », sur les relations complexes qui peuvent parfois se nouer entre existence et littérature…
Preuve s’il en est qu’une revue n’épuise jamais rien. Elle laisse toujours derrière elle des chemins où « revenir ». Et c’est tant mieux…
Propos recueillis par Frédéric DIEU
La moitié du fourbi
22, rue Pablo Picasso
93000 BOBIGNY
France
Courriel : revue@lamoitiedufourbi.org
Réseaux sociaux : Facebook / Twitter
Crédits photographiques : Christophe Burine








































