
« La ville ouverte » de Samuel Gallet : il faut savoir commencer une guerre

Samuel Gallet, déjà auteur de six pièces de théâtre parues aux éditions Espaces 34, en publie une septième intitulée La ville ouverte. Une ville ouverte, c’est normalement, en temps de guerre, une ville sanctuarisée, que les combattants de chaque camp s’entendent pour épargner et pour épargner ainsi ses habitants ou ses richesses culturelles. On sait grâce à Roberto Rossellini que Rome bénéficia de ce statut pendant la Seconde Guerre mondiale.
Mais la ville ouverte de Samuel Gallet n’est pas (du moins pas tout à fait) ce lieu sanctuarisé, épargné par les combats. Elle apparaît en effet comme une ville mise à nu, comme un monde révélé dans sa violence et sa cruauté ; elle s’ouvre comme une oreille s’ouvre au cri du monde, au cri dans soi, s’ouvre à ce qui était tu.
La ville comme champ de bataille
Celle ville ouverte est champ de bataille bien plus que sanctuaire ; ce champ de bataille est à la fois extérieur, fait d’une oppression et d’une exploitation qui jusqu’alors étaient tues par la marche et le bruit du monde, et intérieur, fait de mille renoncements intimes, des mille défaites et humiliations secrètes que l’on subit dans le but de s’adapter à la marche et au bruit du monde : travail, divertissements et pauvreté affective.
C’est contre cela, contre cette tyrannie, que les trois personnages féminins de la pièce partent en guerre, avec cette particularité que leur campagne se déroule de nuit, car en rêve : drapée dans ce rêve comme dans une plus vaste tunique, leur révolte peut rejoindre l’histoire et la mythologie et prendre ainsi une dimension universelle et même éternelle (car totalement « transhistorique »). En rêve, ces trois personnages deviennent des tyrannicides : cette épée de Damoclès qui était suspendue au-dessus d’elle, qui est suspendue au-dessus de la ville, qui est suspendue au-dessus du monde, c’est au fond comme si elles s’en saisissaient aussi pour la retourner contre le tyran.
Cette épée de Damoclès suspendue au-dessus de nous est l’épreuve que nous ne devons pas refuser, que nous devons affronter : d’une certaine manière, il faut prendre l’arme ou rendre l’âme. Elle vient, cette épée, couper en son milieu le fruit rond qu’est la terre, nous traverser de part en part pour le pire (la sensation d’une chute permanente et sans fin de tout, le sol qui nous manque, l’angoisse devant la force avec laquelle le monde court à sa perte) et le meilleur (le parler tranchant retrouvé, le désir d’innocence et de pureté, la soif d’aimer en vérité). C’est pour tout cela qu’il faut lire la pièce de Samuel Gallet dont l’argument, le déploiement et le langage (malgré les deux intermèdes consacrés aux flatteries de Damoclès qui nous semblent être une concession malheureuse au parler médiatique de ce temps) se situent à cette hauteur historique et tragique qui ennoblit l’auteur et son lecteur en leur faisant franchir ensemble les portes de la vérité.
Ce que la marche du monde engendre mais ne dit pas
Il y a, au départ, ceci qui hante les trois personnages :
« Batailles perdues
Lois scélérates
Marées noires
Continents qui chavirent
Incendies et massacres »
Il y a, couvrant cette réalité du monde, le discours anesthésiant et rassurant du monde et le monde est ici tout ce qui « filtre » la réalité et nous en détourne : médias, consommation, divertissements et tous les écrans placés entre le monde et soi. Il y a donc la servitude et l’anesthésie volontaires, malgré (ou peut-être à cause de) l’épée suspendue.
Cette épée, mieux vaut pourtant la voir car si elle est une menace, elle est aussi une arme, un langage tranchant et vrai pour dire ce que la marche du monde engendre mais ne dit pas. Elle est l’épée du langage, afin que « les mots attaquent agrippent s’emparent du monde tordu / Et lui redonnent une forme ».
Le sommeil et le rêve révèlent le vrai visage de la ville et du monde civilisés
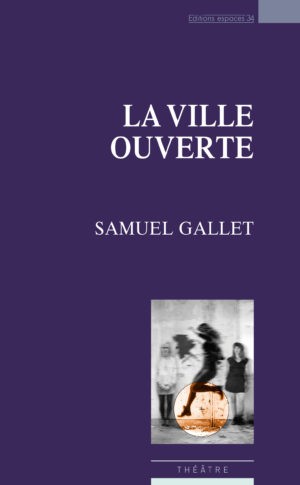 Barricadés en eux-mêmes (dans leurs remparts), durant le jour, pour ne pas s’écrouler devant la vulgarité et la brutalité de leur vie quotidienne, les trois personnages féminins deviennent, pendant leur sommeil, par la vertu de leurs rêves et des transpositions historiques qu’ils autorisent, des villes ouvertes où se révèlent dans toute leur étendue la guerre, l’esclavage et la cruauté qui étaient tus durant le jour. Où peut aussi se dérouler le combat que ces femmes ne mènent pas durant le jour. Pendant leur sommeil, les trois femmes, fatiguées de la vie urbaine contemporaine, deviennent les personnages d’une tragédie antique : réduites à l’état d’esclaves dans un camp de prisonniers de Sicile, qui est la ville ouverte car appartenant aux populations défaites et soumises par Denys l’Ancien, tyran de Syracuse, elles fomentent le meurtre de ce dernier. Syracuse, la cité du tyran, est en effet assiégée mais parvient à faire périr les navires ennemis remplis d’exilés qui s’en approchent, dont les rescapés viennent grossir le camp et constituent une main d’œuvre aisément corvéable et, s’agissant des femmes, un « réservoir » d’esclaves sexuelles destinées à assouvir les désirs et les caprices du tyran (lorsqu’elles sont appelées au « Château », qui évoque Kafka). Comment ne pas voir dans cette Syracuse de rêve le visage tout à la fois déformé et plus vrai de l’Europe réelle d’aujourd’hui, assiégée, notamment sur ses côtes siciliennes, par des embarcations pleines d’exilés qui constituent une population aisément exploitable et un réservoir de prostituées bon marché ?
Barricadés en eux-mêmes (dans leurs remparts), durant le jour, pour ne pas s’écrouler devant la vulgarité et la brutalité de leur vie quotidienne, les trois personnages féminins deviennent, pendant leur sommeil, par la vertu de leurs rêves et des transpositions historiques qu’ils autorisent, des villes ouvertes où se révèlent dans toute leur étendue la guerre, l’esclavage et la cruauté qui étaient tus durant le jour. Où peut aussi se dérouler le combat que ces femmes ne mènent pas durant le jour. Pendant leur sommeil, les trois femmes, fatiguées de la vie urbaine contemporaine, deviennent les personnages d’une tragédie antique : réduites à l’état d’esclaves dans un camp de prisonniers de Sicile, qui est la ville ouverte car appartenant aux populations défaites et soumises par Denys l’Ancien, tyran de Syracuse, elles fomentent le meurtre de ce dernier. Syracuse, la cité du tyran, est en effet assiégée mais parvient à faire périr les navires ennemis remplis d’exilés qui s’en approchent, dont les rescapés viennent grossir le camp et constituent une main d’œuvre aisément corvéable et, s’agissant des femmes, un « réservoir » d’esclaves sexuelles destinées à assouvir les désirs et les caprices du tyran (lorsqu’elles sont appelées au « Château », qui évoque Kafka). Comment ne pas voir dans cette Syracuse de rêve le visage tout à la fois déformé et plus vrai de l’Europe réelle d’aujourd’hui, assiégée, notamment sur ses côtes siciliennes, par des embarcations pleines d’exilés qui constituent une population aisément exploitable et un réservoir de prostituées bon marché ?
La langue de Samuel Gallet est ici dure et crue, tragique, presque shakespearienne. À la jeune femme du camp qui a cette fois été choisie pour rejoindre le château et le tyran durant l’orgie (elle est Erine le jour et donc la rescapée choisie la nuit), il est dit par les autres femmes :
« Nous ne savons pas si tu reviendras demain
Car l’homme se soulage de son désir
Et il a ensuite honte de son désir
Et il voudrait l’oublier aussi vite
Et alors il enterre ses déchets dans la terre
La souillure dans la terre
Et le sexe de la femme est la chose sale
Alors il faut l’enterrer vite avec les déchets
Pour ne pas être impur »
Le rêve historique et tragique, tel un microscope, grossit, révèle et dit l’horreur du monde diurne contemporain. Des réminiscences cinématographiques apparaissent : la jeune prisonnière passant à travers le grillage du camp pour rejoindre le tyran rappelle, dans le Stromboli de Roberto Rossellini, Ingrid Bergman, prisonnière dans un camp italien entouré de grillage, qu’un soldat italien courtise de l’autre côté de ce grillage et finit par mener sur son île. La scène d’orgie (« Les visages tordus se réfléchissent dans les miroirs rouge sang ») rappelle celle du Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick.
Figure du tyran
Pour Suzanne, le tyran semble être, dans le monde diurne contemporain, l’homme qui vit avec elle, celui qui voudrait un enfant d’elle et dont elle s’imagine qu’elle lui « plante une arme dans le cœur ». En rêve, Suzanne est une jeune femme qui a été une fois choisie par le tyran, a voulu le tuer mais n’a pas eu le courage de le faire : celui-ci l’a relâchée pour, semble-t-il, l’humilier davantage.
Mais l’on peut penser que le tyran, c’est, de façon plus métaphorique, le monde cruel campé sur ses appuis, campé sur l’injustice et l’oppression : c’est le rêve qui révèle qu’une épée est suspendue au-dessus de lui et que le sol menace de se dérober sous lui. En rêve, cette épée devient l’épée de la vérité, l’épée d’une sentence de meurtre proférée. Le rêve des trois jeunes femmes leur révèle « la splendide nécessité du meurtre ». Plutôt qu’une personne, le tyran est une figure composite, monstrueuse, agrégeant en elle la somme de toutes les aliénations, oppressions, injustices, perversions. C’est tout cela qui se cache, nous semble-t-il, derrière la figure de Denys de Syracuse. C’est finalement Damoclès qui, s’emparant de l’épée qui était suspendue au-dessus de lui tout le temps qu’il « remplaçait » le tyran, tue Denys, privant la jeune esclave du meurtre qu’elle avait préparé : c’est sur un corps sans vie que celle-ci s’acharne. L’on peut penser que ce meurtre du tyran à l’aide de l’épée qui toujours menace celui-ci marque un renoncement au pouvoir injuste, à la puissance démesurée.
Une époque imprévisible
La traversée du sommeil, le franchissement du rêve (et l’affranchissement qu’il permet) conduisent sur une autre rive, débouchent sur une « autre réalité ». Deux des personnages fuient leur quotidien pour se réfugier dans une « petite ville près de la mer ». Le troisième, Erine, qui, en rêve, fut « choisie » pour divertir le tyran puis s’acharna sur son corps laissé sans vie par son meurtrier, se retrouve hagarde dans cette même petite ville, les mains couvertes de sang, signe d’une continuité entre le rêve de la nuit et la réalité du jour.
L’autre réalité à quoi mène le rêve n’est plus banale, oppressante et irrespirable mais imprévisible. Imprévisible et équivoque, imprévisible et angoissante, le rêve et la nuit ayant fait se dérober le sol que, le jour d’avant, l’on croyait ferme. Angoissante ainsi que le dit, que le profère, Erine : « Le sol a disparu. La chute dure… Et tombent les gens. Les corps autour de moi… Nous nous mettons à parler. Avez-vous une idée de là où nous allons ? De notre destination finale ? De là où nous pourrions nous écraser enfin ? Avez-vous trouvé un lieu pour vivre ?« . Questions, ouvertes, que l’on se pose lorsque l’on séjourne dans le monde comme dans une ville ouverte.
Samuel Gallet, La ville ouverte, Espaces 34, 2018, 88 p., 15 €

































