
Jonas Hassen Khemiri : « Je m’amuse plus quand j’écris du théâtre »

Né à Stockholm en 1978, Jonas Hassen Khemiri obtient une notoriété considérable dès l’âge de 25 ans, avec la publication de son premier roman un rouge œil. Cinq romans et six pièces plus tard, il est désormais considéré comme l’un des écrivains suédois les plus importants de sa génération : plus de 500 000 livres vendus dans son pays, traduction de ses œuvres dans une dizaine de langues…
De passage à Avignon à l’occasion de la représentation, en juillet dernier, de sa pièce J’appelle mes frères publiée aux éditions Théâtrales, Jonas Hassen Khemiri a répondu à nos questions dans un français quasiment irréprochable.
Entretien.
À quand remontent vos premiers essais d’écriture ?
J’ai commencé à écrire dès l’âge de six ou sept ans, dans un journal intime. Déjà à cette époque, je trouvais hallucinant le fait que je puisse écrire des faits qui restent plus longtemps que mes souvenirs. Ce que j’écrivais était des choses simples et banales, mais le fait que je puisse le faire a changé ma vie. Cela me donnait un sentiment de stabilité dans un monde que je trouvais dangereux. J’ai toujours rêvé d’écrire. À l’université, j’ai suivi un enseignement en économie et en littérature.
Pourquoi l’économie ?
J’avais besoin de quelque chose d’un peu stable, de réel, pour continuer à écrire. Mais au lieu d’aller jusqu’au diplôme, j’ai publié mon premier roman. C’était en 2003, j’avais vingt-cinq ans. Depuis, je vis comme écrivain.
En août est publié en Suède votre cinquième roman, auquel il faut ajouter une collection de pièces, de petites histoires. Votre succès en Suède est impressionnant, avec plus de 500 000 livres vendus.
Je ne pouvais pas imaginer un tel succès. Ce qui m’est arrivé en Suède est assez rare. Dès le premier livre, j’ai eu des lecteurs, ce qui m’a donné l’opportunité de continuer à écrire.
Outre vos romans, vous avez publié six pièces de théâtre, certaines étant traduites en français par les éditions Théâtrales. Comment ce genre littéraire vous est-il venu ?
Si je me définis comme romancier, ma créativité aime être surprise. Je ne veux pas rester dans des formes trop confortables pour moi. C’est pourquoi j’ai écrit des pièces de théâtre. Mon frère est acteur ; moi, je préférais les livres. Mais une association nous donnait des billets pour des pièces en répétition. C’est là que j’ai compris le théâtre : il y avait une tension du fait que les pièces n’étaient pas terminées. Dans mes propres textes, il y a aussi ce goût pour l’inachèvement. Cela ne m’intéresse pas de montrer un monde parfaitement clair ; je souhaite plutôt que le spectateur puisse s’engager pour ajouter quelque chose dans ce monde fictionnel.
Comment s’est opéré concrètement le basculement du roman au théâtre ?
Après la publication de mon premier roman, le directeur du théâtre municipal de Stockholm m’a contacté pour l’écriture d’une pièce. Il m’a dit : « Tu peux écrire ce que tu veux, mais j’ai quelques idées… » (rires). Il a énoncé des sujets banals, voire superficiels ; j’ai refusé. En rentrant chez moi, j’ai lu une pièce de Carl Jonas Love Almqvist, un auteur suédois que plus personne ne lit maintenant et que j’aime bien. Dans cette pièce, il y a un personnage qui s’appelle Abulkasem, qui m’a tout de suite fasciné : j’ai alors proposé au directeur d’écrire une pièce sur les mille visages d’Abulkasem. Je m’attendais à un refus ; il a aussitôt accepté. Je me suis senti tout à coup libre au théâtre. Ce fut mon premier texte : Invasion ! Cinq autres ont suivi, dont J’appelle mes frères qui a été joué à Avignon en juillet dernier.
Dans cette dernière pièce précisément, le héros communique avec sa grand-mère décédée. L’absence et le souvenir semblent être une double constante dans vos écrits.
C’est effectivement un de mes thèmes de prédilection. Je me souviens, quand j’ai commencé à écrire mon journal intime, que j’écrivais souvent sur des gens qui n’étaient alors pas présents, soit qu’ils étaient loin pour des raisons politiques ou économiques, soient qu’ils étaient morts. C’était une manière de les tenir proches de moi. Mes romans comme mes pièces de théâtre évoquent régulièrement des personnes qui sont parties, disparues ou mortes. Ceux qui restent essayent de les remplacer avec des mots. Dans mon dernier roman paru en français chez Actes Sud, Tout ce dont je ne me souviens pas, un jeune homme nommé Samuel est mort dans un accident ou un suicide ; le livre raconte les souvenirs qu’il a laissés derrière lui, auprès de toutes les personnes qui le connaissaient : sa famille, ses amis, sa compagne… Ils essaient de ressaisir qui était Samuel, mais chacun se souvient de lui dans un contexte différent. Plus que le souvenir comme tel, c’est la subjectivité liée au souvenir qui m’interroge.
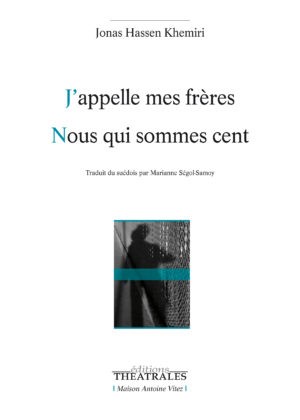 Le cœur de J’appelle mes frères semble être la question du préjugé. On évoque souvent, en Occident, les clichés à l’égard des immigrés et enfants d’immigrés. Dans votre pièce, vous soulignez qu’ils existent dans les deux sens.
Le cœur de J’appelle mes frères semble être la question du préjugé. On évoque souvent, en Occident, les clichés à l’égard des immigrés et enfants d’immigrés. Dans votre pièce, vous soulignez qu’ils existent dans les deux sens.
Cette pièce raconte l’histoire d’Amor, un homme très isolé, totalement seul, qui communique avec les gens grâce à son portable. Nous le suivons pendant vingt-quatre heures, comme si nous étions dans sa tête. Au début de la pièce, un attentat terroriste frappe Stockholm. Amor est alors convaincu que tout le monde le voit comme un criminel. L’est-il vraiment ? Est-il paranoïaque ? Est-ce la ville qui l’est ? Ces préjugés reposent sur des mythes : le méchant policier, le gentil jeune, etc. Ce qui m’a toujours intéressé, c’est de détruire ces présupposés infondés. Et pourtant, depuis que je suis jeune, je n’ai jamais vu d’uniforme de policier sans me sentir inconfortable. La raison est claire : j’ai grandi dans une ville où j’ai fait l’expérience que la police n’était pas toujours mon amie. Quand j’étais avec des amis issus des quartiers riches, il n’y avait jamais de problème : les policiers me traitaient gentiment. Mais avec mes amis pauvres, nous étions parfois considérés comme des criminels.
La Suède est pourtant présentée en France comme un pays de tolérance, d’ouverture, d’innovation dans l’éducation…
D’un certain côté, c’est vrai. Mais c’est comme tout : il faut des nuances. Du point de vue du féminisme, nous sommes plutôt en avance. Du point de vue des discriminations, je serais moins schématique : mon expérience n’est pas toujours en accord avec les mythes officiels.
En quoi le fait d’avoir un père tunisien et une mère suédoise a marqué votre enfance et votre écriture ? Est-ce que cette double culture a pu vous rendre étranger, à la fois au monde suédois et à celui tunisien ?
Non. Mais cela m’a montré dès mon enfance que les groupes essaient toujours de trouver quelqu’un qui ne fait pas partie de leur communauté. J’étais toujours sensible à cette dimension, y compris quand j’ai fait des études d’économie : peu à peu, les étudiants se sont mis à parler et à s’habiller différemment, constituant un groupe. C’est fascinant de constater comment les groupes se constituent. Et puis il y a la question de la langue : à la maison, nous parlions arabe, suédois et français, pour des choses différentes.
Les mots sont-ils liés pour vous à une hiérarchie de pouvoir ?
Oui, exactement. Dans mes écrits, j’utilise précisément ces langues et m’intéresse à la collision qui existe non seulement entre elles, mais au sein de chacune d’elles. Dans toutes les langues, il y a différentes manières de parler. Par exemple, à Avignon, il y a un clash qui existe entre le langage du théâtre et celui de la rue. Dans J’appelle mes frères, je confronte différentes langues, donc des logiques divergentes.
Vous parlez des différents types de langages au sein d’une même langue. Y a-t-il une différence pour vous entre l’écriture théâtrale et l’écriture romanesque ?
Ce qui m’intrigue dans le théâtre, c’est tout ce que je ne peux pas faire dans les livres. Dans un roman, je ne peux pas contrôler la vitesse, alors que le rythme de mes pièces est très rapide. Ça bouge vite ! Pour le reste, il y a beaucoup de similarités : je commence avec une histoire que je vais raconter, et j’essaie de trouver la forme optimale. Ce qui m’intéresse, c’est l’énergie dans les mots, sur scène… Pour être honnête, j’ai de temps en temps l’impression que je m’amuse plus quand j’écris du théâtre, parce que ce n’est pas mon vrai métier. C’est peut-être une façon pour moi de garder la joie d’écrire : je me dis que je suis un romancier qui écrit des pièces.
Propos recueillis par Pierre GELIN-MONASTIER
Ouvrages de Jonas Hassen Khemiri mentionnés dans cet entretien :
– Invasion !, trad. Suzanne Burstein, Éditions Théâtrales, 2008, 64 p., 9 €
– J’appelle mes frères, trad. Marianne Ségol-Samoy, Éditions Théâtrales, 2013, 144 p., 19 €
– Tout ce dont je ne me souviens pas, Actes Sud, 2017, 336 p., 22,50 €
Photographie de Une – Jonas Hassen Khemiri (crédits : Thron Ullberg)

































