
Don, contredon et abandon
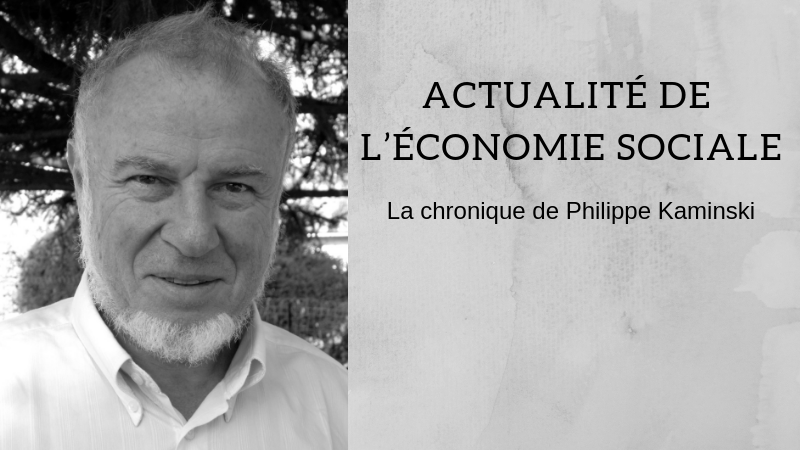
N’en déplaise à Marcel Mauss et à toute la foule d’affreux gloseurs qui se réclament encore de lui, il n’y a plus aujourd’hui de don, donc plus de matière à contredon. Il y a bien des cadeaux, des donations, des aumônes, des soutiens aux œuvres caritatives et humanitaires, devenues une industrie à part entière… mais pas de don. Pour notre chroniqueur, l’époque est plutôt à l’abandon.
Actualités de l’économie sociale
Il est des auteurs, des penseurs, devant lesquels certains s’extasient, devant lesquels il est de bon ton de s’extasier, et qui ne me disent rien. Marcel Mauss a toujours été de ceux-là.
Je le juge inintéressant et inadéquat. Et aussi, ce qui est sinon plus grave, du moins plus prégnant, précurseur et inspirateur d’une foule d’affreux gloseurs que je rejette autant que lui.
Je ne comprends pas pourquoi tant de présentations de l’Économie Sociale en font une sorte de « Maître caché ». Ou plutôt je le comprends trop bien : Mauss était marxisant sans trop le proclamer, révolutionnaire mais se bornant à des prêches convenus sur la fraternité et la tolérance ; on pouvait donc s’en revendiquer sans craindre de quitter le monde des idées pures et des mains innocentes.
En gros, quelles sont les thèses qu’on lui attribue ? Que la solidarité, l’entraide, l’engagement bénévole, le besoin de l’Autre et tout ce qui en découle, nous viennent du fond des âges et que l’étude des pratiques du don dans les sociétés primitives nous enseigne les voies à suivre pour parvenir à une société meilleure, sans classes et sans domination. Car nous sommes face à deux ennemis du genre humain : d’une part la submersion de nos penchants naturels à la gratuité et à la générosité par la machine économique et par son hideux visage, le capitalisme, qui concentre la richesse entre les mains de quelques-uns et multiplie la misère chez les autres ; et d’autre part la pratique de l’aumône et de la charité, qui fige et perpétue les rapports d’inégalité entre donateurs et bénéficiaires, entretenant ceux-ci dans un état dégradant de sujétion et d’infériorité sociale. Pour surmonter ce tropisme de « la main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit », Mauss invente le principe du contredon, qu’il croit discerner dans les pratiques des sauvages de Bornéo ou d’ailleurs ; ainsi, la devise d’une société heureuse doit-elle tenir en trois commandements, savoir donner, savoir recevoir, savoir rendre.
Tout cela a des résonances roussiennes, et semble fort gido-compatible, bien que j’ignore si Gide et Mauss se sont jamais rencontrés. En effet, bannir à la fois le capitalisme et la charité privée ne peut qu’ouvrir la voie à l’intervention de l’État et à la parer d’avance de toutes les vertus.
Cette conséquence logique devrait me suffire à rejeter Mauss. Mais je pense utile de l’attaquer aussi sur son propre terrain. Écoutons-le :
Il est possible d’étendre ces observations à nos propres sociétés. Une partie considérable de notre morale et de notre vie elle-même stationne toujours dans cette même atmosphère du don, de l’obligation et de la liberté mêlés. Heureusement, tout n’est pas encore classé exclusivement en termes d’achat et de vente. Les choses ont encore une valeur de sentiment en plus de leur valeur vénale, si tant est qu’il y ait des valeurs qui soient seulement de ce genre. Nous n’avons pas qu’une morale de marchands. Il nous reste des gens et des classes qui ont encore les mœurs d’autrefois et nous nous y plions presque tous, au moins à certaines époques de l’année ou à certaines occasions. Le don non rendu rend encore inférieur celui qui l’a accepté, surtout quand il est reçu sans esprit de retour. La charité est encore blessante pour celui qui l’accepte, et tout l’effort de notre morale tend à supprimer le patronage inconscient et injurieux du riche aumônier.
Puis, plus loin :
Ce sont nos sociétés d’Occident qui ont, très récemment, fait de l’homme un animal économique. Mais nous ne sommes pas encore tous des êtres de ce genre. Dans nos masses et dans nos élites, la dépense pure et irrationnelle est de pratique courante ; elle est encore caractéristique des quelques fossiles de notre noblesse. L’homo oeconomicus n’est pas derrière nous, il est devant nous ; comme l’homme de la morale et du devoir ; comme l’homme de la science et de la raison. L’homme a été très longtemps autre chose ; et il n’y a pas bien longtemps qu’il est une machine, compliquée d’une machine à calculer. D’ailleurs nous sommes encore heureusement éloignés de ce constant et glacial calcul utilitaire. Qu’on analyse de façon approfondie, statistique, comme M. Halbwachs l’a fait pour les classes ouvrières, ce qu’est notre consommation, notre dépense à nous, occidentaux des classes moyennes. Combien de besoins satisfaisons-nous ? et combien de tendances ne satisfaisons-nous pas qui n’ont pas pour but dernier l’utile ? L’homme riche, lui, combien affecte-il, combien peut-il affecter de son revenu à son utilité personnelle ? Ses dépenses de luxe, d’art, de folie, de serviteurs ne le font-elles pas ressembler aux nobles d’autrefois ou aux chefs barbares dont nous avons décrit les mœurs ?
Certes, ces extraits des conclusions de l’Essai sur le Don ont été écrits en 1924. Et pour ne pas avoir à insister sur les bouleversements provoqués par la Grande Guerre, considérons que Mauss se réfère à la France de 1914, c’est à dire à une société très majoritairement rurale, où l’agriculture qui n’est pas encore mécanisée n’est pas très différente de ce qu’elle était au temps de Sully, voire bien avant. Accordons donc à Mauss qu’il a pu y observer des rémanences de très anciennes croyances ou coutumes. Mais que ses disciples maussiens pensent que celles-ci subsistent dans la France de 2020, c’est absurde. Dans les sociétés archaïques, l’individu ne s’était pas encore affirmé face au collectif, et les divinités imprégnaient tout ce qui faisait la vie de chaque jour. Qu’il en soit resté quelque trace dans nos campagnes de 1914, soit. Mais aujourd’hui, alors que la sécularisation est arrivée à son terme, que l’individu est devenu souverain sans partage, que tout est rendu monétaire, fiscalisé, numérisé, les « mœurs d’autrefois » sont aussi vivantes et déterminantes que les squelettes de dinosaures dans les sables de l’Arizona.
Le vingtième siècle a produit beaucoup d’ethnologues, prolongés en anthropologues et sociologues. Nombre d’entre eux ont alimenté un front commun de rejet de l’économie, cette gangrène moderne qui recouvrirait, qui oblitérerait les caractères naturels et ancestraux de l’être humain. Ceci en soi n’est pas faux. Mais déplorer l’avènement de l’homo œconomicus conduit naturellement à minorer le rôle de l’économie, puis à ne pas l’étudier, donc à ne pas la connaître, et en fin de compte à en dire n’importe quoi.
On peut ne pas apprécier le monde moderne, et je suis souvent dans ce cas. Tel un vieux Juvénal, je traverse en maugréant les travées de cette immense grande surface vide de sens, rêvant de trouver la force de chasser d’un coup de balai vengeur toute la pourriture de ces marchands du Temple qui m’y agressent de leurs publicités insanes et de leur marchandise factice. Mais une fois qu’on a râlé un bon coup, il faut bien vivre et faire avec. Nos temps sont durs, mais ce sont nos temps.
Et dans nos temps, il n’y a plus de don, donc plus de matière à contredon.
D’abord, il ne faut pas confondre le don et le cadeau, marchandise futile par excellence, qui à peine offerte est revendue en l’état sur tel ou tel site en ligne. Il ne faut pas le confondre avec la donation, dispositif juridique et fiscal qui permet d’adapter les transmissions successorales à l’allongement des durées de vie. Il ne faut pas le confondre avec l’aumône, qui ne subsiste qu’à l’état de réponse à l’industrie de la mendicité organisée. Il ne faut surtout pas le confondre avec le soutien aux œuvres caritatives ou humanitaires.
Car dans cette activité, qui est devenue une industrie à part entière, il n’y a plus rien qui ressemble à un contact entre le donateur et le bénéficiaire. Deux écrans les séparent : l’organisme collecteur, en concurrence féroce avec ses pairs pour se disputer le « marché de la générosité », et surtout l’État, qui par le biais des déductions fiscales, oblige le contribuable à abonder le versement initial pour faire, de ce qui est présenté de manière attrayante mais fallacieuse comme une opération de bienfaisance, un simple appendice de la solidarité publique. Le bénéficiaire n’aura jamais vu le donateur, et on lui aura bien expliqué que, régime obligatoire ou dispositif humanitaire, il n’a personne à remercier car il ne fait que faire valoir ses droits.
Enfin, comment Mauss peut-il oser comparer les dépenses somptuaires des riches à un don ? Ces frasques n’ont rien à voir avec les grandes fêtes de l’Antiquité, empreintes de sacralité et faisant fonction de ciment social ; elles sont aujourd’hui bourgeoises, privatives, fermées, égoïstes.
Mais notre monde marchand et bourgeois ne fait pas que tourner le dos au don. Il lui a ouvert, paradoxalement, de nouvelles portes, et lui a livré de hautes montagnes de richesses accumulées et en déshérence, ceci du fait du vieillissement de la population. L’épargne, on le sait, est concentrée chez les plus âgés. Tous n’ont pas d’héritiers jeunes et créateurs d’entreprises, tous ne sont pas contraints de se ruiner au profit de leur EHPAD de résidence. Il reste, dans les pays riches, énormément d’épargne aux mains de gens qui, vu leur âge, n’ont plus envie de rien. Malgré la fiscalité qui pèse sur eux, malgré toutes les sollicitations qui leur sont adressées, ils sont de plus en plus riches.
Eh bien, qu’ils le veuillent ou non, ces sommes inutilisées ressuscitent quelque peu le potlatch des primitifs. C’est la loi de la macroéconomie, qui s’apparente ici à la physique élémentaire ; quand il n’y a pas assez de demande d’investissement pour utiliser l’épargne disponible, celle-ci s’érode et se perd. Les taux d’intérêt négatifs en sont une illustration visible. Bien sûr, personne ne bénéficie de ce sacrifice de fait qui n’est plus à proprement parler du don, mais de l’abandon.
.
Lire les dernières chroniques de Philippe Kaminski
– Mais qu’est-ce qui nous fait courir ?
– Lettre à Paul St-Pierre Plamondon : “Il vous faudra innover, tout en retrouvant vos racines”
– Solidaire ou solitaire ?
– Retour à l’émancipation ?
.
* Spécialiste de l’économie sociale et solidaire (ESS) en France, le statisticien Philippe Kaminski a notamment présidé l’ADDES et assume aujourd’hui la fonction de représentant en Europe du Réseau de l’Économie Sociale et Solidaire de Côte-d’Ivoire (RIESS). Il tient depuis septembre 2018 une chronique libre et hebdomadaire dans Profession Spectacle, sur les sujets d’actualité de son choix, afin d’ouvrir les lecteurs à une compréhension plus vaste des implications de l’ESS dans la vie quotidienne.

































