
Tropismes mis en tropes
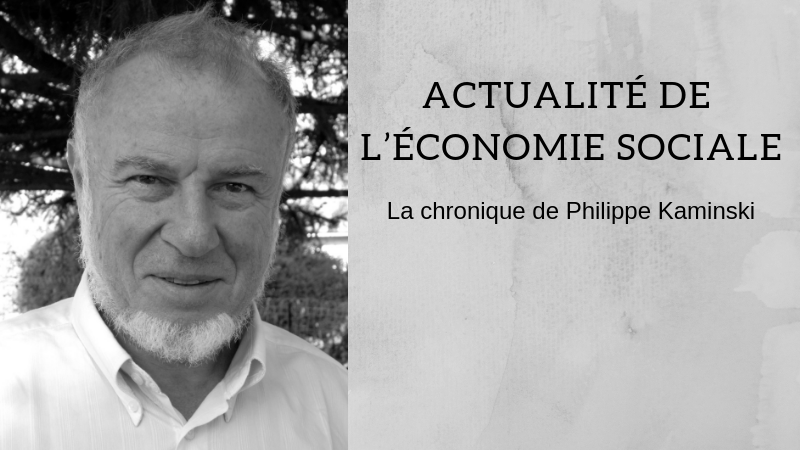
La passion des collectionneurs ne saurait être un privilège d’État. C’est justement de la complémentarité, de la saine émulation entre public et privé que naît la qualité de la connaissance et de la transmission.
Actualité de l’économie sociale
Cette astuce a dû être proférée mille fois au temps où il y avait des classes de rhétorique. Comme tout cela est désormais enseveli en un profond oubli, j’en revendique, l’ayant réinventée de toutes pièces, la paternité exclusive. J’en ai déposé le brevet, et nul ne pourra désormais l’employer sans en citer la source et me verser une licence (de quatrième catégorie, les seules qui vaillent).
*
Et la cour et la ville
Ne m’offrent rien qu’objets à m’échauffer la bile
Les amis de mes amis sont mes amis. Ce vieil adage que tout controuve, je crois l’avoir appris jadis en cours de maths, comme illustration du fait que « plus par plus égale plus ». Mais en littérature on m’a plutôt enseigné le contraire : Oreste aime Hermione, Hermione aime Pyrrhus, cela n’implique pas qu’Oreste et Pyrrhus soient de bons camarades.
Si mon prochain est détestable, puis-je revendiquer le droit de le détester ? Même si nous sommes l’un et l’autre amis d’un même tiers qui n’en peut mais ? Et celui qui en peut encore moins que tous les autres, c’est celui qui est mort et enterré ; on peut lui faire dire ce qu’on veut. C’est ainsi que je reçois un avis de souscription pour un livre d’hommages à Frédéric Dard, à l’occasion du centenaire de sa naissance. Et c’est signé « les Amis de San Antonio ».
Pour sûr, j’en suis, moi, des amis de San Antonio ! Mais quand je vois la liste des contributeurs à cet ouvrage, beurk ! J’y trouve des énergumènes qui me semblent aussi capables d’apprécier les saillies de Bérurier que moi les appendices de la constitution civile du clergé. Me retrouver en leur compagnie, merci !
Que faire ? Créer une association rivale, les « Véritables Amis de San Antonio et de Bérurier » ? Oui, mais sur quels critères prouver que l’on est « véritable » ? C’est peine perdue. Je me souviens, encore des réminiscences de vétéran cacochyme, avoir créé dans mon école une bourse d’échange de San Antonio… et déjà (pour situer l’époque, ce devait être un peu avant mai 68), la nostalgie dominait. Car dans les éditions originales, les poursuites se faisaient en Traction, alors que dans les dernières réimpressions il n’y avait plus que des DS, et cela n’avait plus le goût d’antan, c’est-à-dire pour nous, le goût du lycée. Chez les collectionneurs, les réflexes de vieux apparaissent très précocement.
En attendant, messieurs-dames les amis posthumes de quelqu’un qui ne vous ressemble pas, vous pouvez vous mettre votre livre d’hommages là où ça vous chante. Vous trouverez dans les bouquins de San Antonio mille et une façons de nommer cet endroit dont l’usage premier est de recevoir des coups de pied mérités, l’usage second étant de s’asseoir.
*
J’enrage, et mon dessein
Est de rompre en visière à tout le genre humain
Un squelette de tricératops, presque complet, a été adjugé il y a peu à Drouot pour un prix record. L’acheteur est un particulier, doté de gros moyens (tant mieux pour lui), qui a le droit d’utiliser son pognon comme bon lui semble. Il doit aussi avoir un salon de dimensions imposantes, car ce genre de bestiau prend plus de place qu’un perroquet empaillé. Mais cela n’a pas été du goût de certains cultureux et autres paléontologues fonctionnaires qui y ont vu comme une spoliation du domaine public. C’est comme si on leur avait retiré un objet qui leur revenait de droit.
À les entendre, seuls les musées d’État auraient la légitimité pour posséder ce genre de pièces. Ils détiendraient, seuls, l’expertise nécessaire pour assurer leur conservation, et seraient, seuls, les dépositaires de la vocation sacrée de partager les connaissances et de les mettre à la portée du grand public. Ce n’est qu’en arpentant leurs travées, et nulle part ailleurs, que la jeunesse rencontrerait le feu sacré de l’Art et s’enthousiasmerait pour les œuvres des grands et petits Maîtres.
Quelle suffisance insupportable, quelle prétention immodeste à un monopole du savoir, et surtout, quel mépris, quelle ignorance de la réalité des passions qui animent le monde des collectionneurs ! Faut-il croire que ceux-ci ne sont tous que des oisifs incompétents, de vils spéculateurs, de jaloux possesseurs de biens qu’ils ne montrent à personne ?
Bien au contraire, seul un collectionneur ivre de sa passion ira pousser ses recherches là où aucun thésard ni aucun fonctionnaire ne va s’aventurer. Il prendra bien davantage soin de ce qu’il chérit et qu’il a payé cher que ne peut le faire un simple préposé à l’entretien d’un patrimoine collectif. Il comprendra aussi, c’est la logique du marché, que son bien ne conservera sa valeur que s’il y a assez d’autres personnes qui aimeraient l’avoir, et il sera donc le premier intéressé à le documenter, à le faire connaître, à le montrer, à le faire admirer et désirer.
Dans le périmètre qui m’est cher, l’histoire postale, 90 % des connaissances sont le fruit du travail des collectionneurs privés.
Certes, le monde du commerce privé de l’art et des objets de collection abrite tous les vices et tous les excès de l’humaine nature. Du moins, tous ceux qui ne sont pas du domaine réservé au secteur officiel, qui n’en est pas avare. C’est justement de la complémentarité, de la saine émulation entre ces deux mondes que naît la qualité de la connaissance et de la transmission. Au contraire, c’est quand ils se regardent en chiens de faïence, quand ils s’ignorent et se méprisent, que les défauts de chacun sont les plus visibles, et les plus nuisibles au bien commun.
Je n’augure rien de bon de la frénésie qui touche actuellement la « restitution » des œuvres des arts dits « premiers » à leur pays d’origine. Que le musée du quai Branly soit vidé de ses trésors n’est pas en soi une catastrophe ; on trouvera bien une autre affectation à ses locaux. Mais les objets, une fois dispersés en une multitude de pays qui n’ont ni les budgets, ni les équipes techniques, ni les capacités touristiques permettant de les mettre en valeur, seront-ils mieux traités ? Dans bien des cas, le mieux qui pourrait leur arriver, c’est qu’un gouvernement cupide et corrompu les mette en vente, sous le manteau ou non, et que des particuliers capables de les aimer et de les faire aimer les rachètent.
*
Tous les hommes me sont à ce point odieux
Que je serais fâché d’être sage à leurs yeux
Je ne suis pas hugolâtre, tout en reconnaissant au bonhomme un talent d’écriture absolument prodigieux. La manière dont a été restaurée sa maison natale à Besançon résume bien le rôle qui lui est désormais dévolu : une espèce de grande conscience réduite à quelques maximes simplettes exprimant de bons sentiments, qui permettent de ramasser du fric sans trop se poser de questions.
Il est vrai que si vous connaissez quelqu’un qui prend plaisir à la lecture des Châtiments ou des Contemplations, prenez bien soin de lui ; c’est une espèce très rare, en voie de disparition.
Avant l’ouverture au public de cette maison restaurée en musée, j’avais pris l’habitude de signaler à la mairie de Besançon les documents concernant Victor Hugo que je voyais passer dans les ventes à Drouot. N’obtenant guère de réponses suivies d’effet, je m’en ouvris un jour au premier adjoint qui, après enquête, m’avoua en toute innocence que les services concernés, ne gérant aucun fonds Hugo, n’avaient pas vraiment compris le parti qu’ils pouvaient en tirer. Ils n’osaient pas faire le premier pas et engager de l’argent public dans un domaine qu’ils ne maîtrisaient pas. Moyennant quoi, le jour de l’inauguration de la maison, celle-ci ne contenait aucune pièce authentique d’époque.
Si la municipalité avait suivi mes conseils, elle aurait fait une excellente affaire, car plusieurs des pièces que j’avais repérées à prix abordable sont parties aux États Unis et valent aujourd’hui beaucoup plus cher. Maintenant, ce sont plutôt les Chinois qui achètent et nul ne peut rivaliser avec eux.
Or il vient de m’arriver une aventure qui me rappelle ces temps pas si lointains.
Un richissime Anglais vient de mettre en vente une grande feuille de papier censée avoir servi d’emballage à l’envoi du manuscrit des Misérables. J’avais déjà vu au moins deux fois ce très spectaculaire document, il y a quelques années, à Monaco puis à Londres. Cette fois, j’ai eu le plaisir de l’avoir en mains et de l’examiner longuement. Le paquet, affranchi à 14 shillings, devait pesait autour de 2,400 kilogrammes. Première erreur sur le descriptif, qui évalue ce poids à 7 livres, soit 3,200 kilos. Hugo écrit sur le coin du document : « La Poste peut se dispenser d’ouvrir ce paquet qui ne contient que des dessins absolument insignifiants », le descriptif osant traduire ce dernier mot par « magnificent« . Il faut le faire ! Et c’est une des plus prestigieuses et des plus anciennes maisons d’enchères de Londres qui cautionne ces énormités…
Le paquet de dessins est donné pour avoir contenu le manuscrit des Misérables. Or rien ne suggère cette affirmation fantaisiste. Les Misérables ont paru en 1862, l’envoi est de Jersey, daté du 10 janvier 1855. Il est adressé à Madame de Girardin, au pavillon Marbeuf, avenue des Champs-Élysées, qui allait mourir d’un cancer quelques mois plus tard. Il n’y a aucune raison que Hugo lui ait envoyé un pré-manuscrit des Misérables maquillé pour la Poste en « dessins insignifiants ».
Delphine de Girardin, déjà malade, avait rendu visite à Hugo en 1853 et l’avait initié au spiritisme. Leurs échanges épistolaires devaient certainement tourner (comme les tables) autour de ces questions bizarres. Juliette Drouet, qui pourtant tenait Madame de Girardin en une haute estime, avait horreur de ces séances pendant lesquelles Hugo, au bord de la folie, tentait de retrouver l’esprit de sa fille défunte Léopoldine. Les dessins (Hugo était un dessinateur très talentueux) portaient sans doute là-dessus, et derrière le mot « insignifiants », il pensait sans doute « ésotériques ».
Malgré mes remarques, la maison de vente londonienne n’a rien changé à son descriptif et le papier a été vendu avec référence explicite aux Misérables. Il était évalué entre 12 000 et 15 000 livres, et a été vendu pour 11 000, ce qui correspond avec les frais à environ 16 000 euros.
Encore un coup à la Jean Valjean !
NB : Je tiens à la disposition des lecteurs intéressés la photo du document ainsi que le commentaire, fautif et tendancieux, qui l’accompagnait.
.
Lire les dernières chroniques de Philippe Kaminski
– Halte à l’asphyxie normative !
– La Tonkinoise et la slalomeuse
– La démocratie : longue vie ou requiem ?
– Culture, immigration, identité
– Vieilleries en tous genres
.
* Spécialiste de l’économie sociale et solidaire (ESS) en France, le statisticien Philippe Kaminski a notamment présidé l’ADDES et assume aujourd’hui la fonction de représentant en Europe du Réseau de l’Économie Sociale et Solidaire de Côte-d’Ivoire (RIESS). Il tient depuis septembre 2018 une chronique libre et hebdomadaire dans Profession Spectacle, sur les sujets d’actualité de son choix, afin d’ouvrir les lecteurs à une compréhension plus vaste des implications de l’ESS dans la vie quotidienne.


































A M Kaminski
Qu’un ou plusieurs des auteurs de l’Album du siècle vous révulsent c’est votre droit. Pour le reste vous ne savez pas qui sont les Amis de San-Antonio (avec un tiret SVP) ni quel rapport nous avons entretenu avec Frédéric Dard ou aujourd’hui avec les membres de sa famille. Je vous prends donc pour un haineux frustré et un parfait imbécile. Je vous chante Les Matelassiers et je vous dis merde, ce qui ne sera pas sans lien avec la fin de votre article
Éric Bouhier