
La première de mes deux morts de Charles Gide
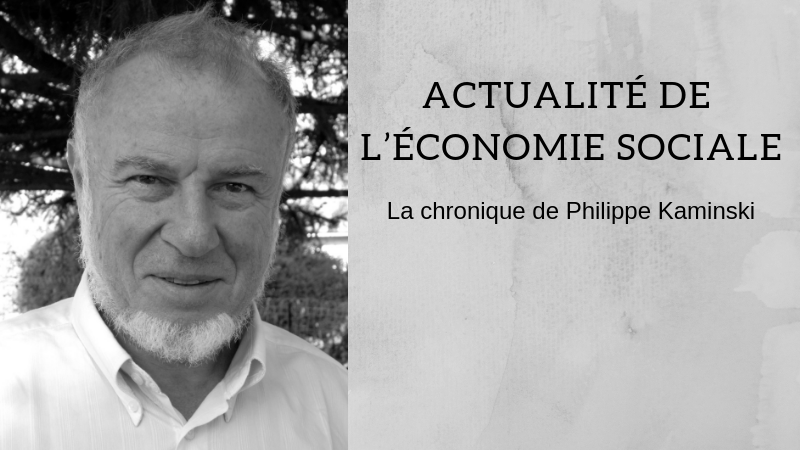
Charles Gide est le dirigeant historique du mouvement coopératif français, théoricien de l’économie sociale et président du mouvement du christianisme social : un père fondateur en quelque sorte, une sommité dans le monde de l’économie sociale et solidaire. Sous la forme amusante d’une anecdote, ou plutôt du conte qui contient sa vérité propre, Philippe Kaminski raconte un périple qui le mène en Europe de l’Est… et à la mort symbolique du grand-homme.
Tribune libre et hebdomadaire de Philippe Kaminski*
Les événements que je vous relate se sont déroulés en avril 2013 et en avril 2018. À cinq ans d’intervalle, presque jour pour jour, il m’a été donné d’assister, voire de participer, à une mise à mort symbolique de l’austère prophète parpaillot dont l’Économie Sociale a fait en France son porte flambeau. Celui-ci n’en revendiquait peut-être pas tant, certes, mais depuis 1932 on ne lui demande plus son avis. Quant à moi, n’ayant jamais été très gidolâtre, je n’ai pu y voir qu’un malicieux clin d’œil du Destin.
Commençons donc par la première de ces deux morts. J’avais eu à l’époque l’intention d’en conter l’aventure par le menu mais, de retard en retard, j’y avais finalement renoncé. Entre temps, les notes que j’avais pu prendre dans le feu de l’action ont disparu, et il ne me reste plus qu’à fouiller dans mes souvenirs, ce qui m’assure au moins de ne pas polluer mon récit avec des éléments de contexte qui n’ont rien à y faire. Le tableau, venu de nulle part, n’en sera que plus saisissant.
Imaginez, pour vous mettre dans l’ambiance, une soirée fraîche, grise et nuageuse, et une longue route droite, immuablement droite, traversant une plaine absolument plate, toujours plus plate où que l’on porte son regard. De temps en temps nous doublons un camion, un monstre antédiluvien crachant de la fumée noire. Il ne faut pas penser aller trop vite, car la chaussée est pleine de trous, voire de cratères. Et le paysage, ce sont des marécages sablonneux à perte de vue, qui n’incitent guère à la joie ni à l’hilarité. Nous filons vers le Nord, plein Nord, en cette morne immensité bientôt enveloppée par le soir qui tombe. Tous les dix kilomètres, un même panneau nous rappelle notre direction : Brest !
C’est un ami qui conduit. Il commence à connaître le pays, mais c’est la première fois qu’il prend cet itinéraire. Derrière nous, son épouse, gravement malade. À côté d’elle et dans le coffre, un fatras d’objets et d’effets personnels, dont deux cartons de livres. En majorité, des Charles Gide plus ou moins défraîchis. Il y a aussi des récits de voyages en Terre Sainte. J’avais apporté tout cela de France à titre de matériau d’essai pour juger du savoir-faire des artisans relieurs du pays. Le résultat n’était pas trop probant. Certains exemplaires revenaient maladroitement reliés, d’autres étaient restés dans leur état d’origine.
En cinq heures, nous avons parcouru trois cent kilomètres. Nous sommes passés à côté de Luboml. Ce nom ne vous dit sans doute rien, mais à moi, il ne m’était pas inconnu. En 1919, ces territoires anciennement tsaristes, qui n’avaient pas été occupés par les bolcheviks et qui étaient destinés à rejoindre la Pologne en cours de reconstitution, connurent diverses émissions de timbres, soi-disant locales et provisoires, mais qui en fait n’ont jamais servi sur place et n’étaient destinées qu’aux philatélistes étrangers. Luboml était de celles-là et j’en possédais plusieurs séries. Le dessin de ces timbres lugubres était aussi affriolant que la route de Brest était touristique.
Mais nous n’allions pas jusqu’à Brest. Peu avant la frontière biélorusse, nous avons obliqué à gauche, c’est à dire vers l’Ouest, en direction de la Pologne. Et là, changement total de décor : les camions, qui se rendaient en Europe, étaient presque tous neufs. À l’approche de la frontière, nous en avons remonté des dizaines et des dizaines, peut-être des centaines, sagement arrêtés en file au bord de la route, attendant leur tour de passer à la douane qui, ce jour-là et pour des raisons que nous n’avons pas cherché à connaître, faisait une grève du zèle. Philosophes, les chauffeurs savaient qu’ils allaient passer là leur nuit, et peut-être plus ; ils en avaient l’habitude. Quant à nous, dans notre voiture française, nous avons vite compris, à voir la tête des gabelous, que l’épreuve n’allait pas être des plus faciles.
On nous rangea sur le bas côté et un gradé, très énervé et quelque peu aviné, vint nous inspecter. Il faisait mine de savoir parler anglais, mais en fait son vocabulaire ne dépassait pas quelques mots. Nos papiers étaient en règle, la voiture ne semblait pas présenter d’anomalies. Il se rabattit sur les livres, qui lui étaient d’autant plus suspects que sa connaissance de l’alphabet latin était aussi limitée que celle de la langue de Shakespeare. Pourquoi transportez-vous ça ? D’où viennent ces livres ? Avez-vous un titre de propriété ? Que vouliez-vous en faire ? À qui les avez-vous montrés ? Ah bon, vous les aviez emmenés de France ? Mais alors, où est votre certificat d’importation ?
Commença alors un ballet d’intimidation. Nous fûmes isolés sur une voie annexe, entourés de quelques gardes armés, et chaque demi-heure un nouvel arrivant venait nous poser les mêmes questions. Nous hésitions sur la conduite à tenir. Résignation passive, séduction à l’aide de quelques billets tentateurs, ou rébellion ouverte ? Nous avions surtout peur que notre passagère se réveille et cherche à sortir. Avec son Alzheimer, elle aurait pu provoquer un incident ingérable. Mais heureusement, malgré le froid, elle continuait à dormir. Chaque nouvelle inspection nous valait un passage en revue des bouquins. Les textes de Gide ne les intriguaient pas trop, mais les croquis de Jérusalem, si ! Ces dessins mystérieux étaient-ils attentatoires à la sécurité du pays ? Serions-nous des espions ramenant chez eux quelques plans secrets ? Vu leur âge, tous ces douaniers avaient fait leurs classes au temps de l’URSS. Ils n’avaient pas perdu la main.
Onze heures passèrent, puis minuit, puis une heure. La situation semblait bloquée, et nous ne nous étions toujours pas accordés sur un discours de défense commun et plausible. Je ne voulais pas évoquer nos projets de reliure, mais je n’avais pas d’idée convaincante à mettre à la place. Tout à coup surgit devant nous une dame. Et, ô miracle, elle nous parlait en français ! Ses propos étaient pleins de suspicion et de menaces. Et comme nous ne savions pas à qui nous avions affaire, les nôtres étaient plus que maladroits. Elle s’était saisie d’un numéro de téléphone griffonné sur un des cartons ; c’était celui d’une amie, professeur de français à Loutsk, qui nous avait hébergés lors de notre passage dans cette ville. Elle n’hésita pas à la déranger en pleine nuit et, au ton qu’elle employait dans leurs premiers échanges, ce n’était pas pour lui décerner les palmes académiques. Quelle poisse ! Nous étions en train d’entraîner nos correspondants dans nos misères.
Mais peu à peu les choses semblèrent s’apaiser. En fait, notre douanière supplétive était elle-même professeur de français, et elle tirait quelques maigres revenus supplémentaires de son activité d’interprète au service des flics. Ceux-ci l’avaient convoquée pour tirer notre affaire au clair ; elle avait dû faire deux heures de route pour nous rejoindre, mais le gros coup qu’elle devait éventer s’avéra être un pétard mouillé. Sa collègue eut vite fait de la persuader que nous n’étions pas de dangereux trafiquants, et surtout que, transportant une personne malade, nous devions être ménagés. Elle se confondit en excuses. Ne leur en veuillez pas, nous dit-elle en désignant les douaniers, ils ne font que leur devoir. Et elle nous aida à inventer pour son rapport un scénario consensuel. J’étais un écrivain. Je transportais avec moi de quoi nourrir mon prochain roman des sources bibliographiques nécessaires. Et j’étais allé chercher l’inspiration dans les profondes forêts bordant la Ruthénie transcarpathique. J’en revenais illuminé par ce merveilleux pays. Un vrai conte de fées.
Cependant, pour sa propre gouverne, elle souhaita en savoir davantage. Feuilletant à nouveau mes bouquins, elle me demanda soudain : Mais qui était-ce, ce Charles Gide ?
- C’était un théoricien des coopératives, lui répondis-je sans vouloir m’étendre.
- Des coopératives ? Elle prit un air attristé. Mais alors, ça n’a vraiment aucun intérêt !
C’est sur cette exécution sommaire et humiliante que nous prîmes enfin la route de la libre Pologne.
À suivre, la seconde mort dans un prochain épisode…
Lire les dernières chroniques de Philippe Kaminski
- Scandale du parachute doré à Audiens : récurrence du superlucratif dans le non lucratif (01/04)
- Grand Débat au Labo de l’ESS : sobriété ou boulimie ? (15/03)
- Ce que veulent les entreprises de l’ESS des pays du Sud (18/03)
- Ces gougnafiers qui nous pourrissent l’existence (11/03)
- Hébétude et Voilàtude (04/03)
.
* Spécialiste de l’économie sociale et solidaire (ESS) en France, le statisticien Philippe Kaminski a notamment présidé l’ADDES et assume aujourd’hui la fonction de représentant en Europe du Réseau de l’Économie Sociale et Solidaire de Côte-d’Ivoire (RIESS). Il tient depuis septembre 2018 une chronique libre et hebdomadaire dans Profession Spectacle, sur les sujets d’actualité de son choix, notamment en lien avec l’ESS.

































